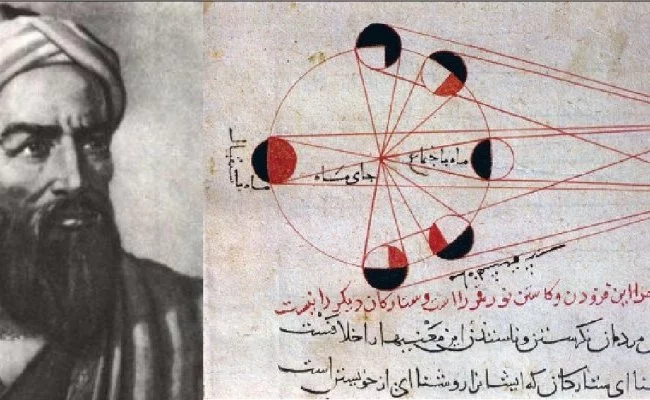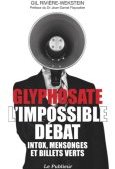OGM : les dangers d’une approche réductionniste des systèmes complexes
Publié en ligne le 30 juin 2004 - Agriculture -« La recherche n’est plus nulle part une recherche de savoir, de connaissance, de compréhension et de sagesse. Elle n’est plus associée à la patiente édification d’un idéal humain : elle procède seulement de l’illusion que nous pouvons aller n’importe où sans avoir besoin de savoir ni où ni pourquoi, que nous pouvons faire n’importe quoi, pourvu que nous sachions comment, parce que nous saurons toujours après coup trouver les correctifs, ou les remèdes, ou des solutions de rechange à la vie elle-même. »
Argumenter sur des problèmes mesurables
Les applications des organismes génétiquement modifiés (OGM) à l’agriculture font l’objet d’un débat passionné. Les protagonistes tendent souvent à camper sur des positions dichotomiques, se définissant soit « pour » soit « contre » les OGM en tant que tels. Une analyse superficielle tendrait à considérer que les partisans fondent leur opinion sur des arguments scientifiques, tandis que les opposants seraient essentiellement motivés par des arguments politiques ou, dans certains cas, métaphysiques. La situation est cependant beaucoup plus complexe, et il est essentiel de distinguer les potentialités d’une technologie de ses modes actuels d’exploitation. S’il est vrai que certains mouvements d’opposition aux OGM sont motivés par des arguments de type métaphysique (ne touchons pas aux frontières naturelles de la vie), il existe aussi des arguments scientifiques pour critiquer la façon dont cette technologie a été déployée jusqu’à présent. Il serait donc trop facile de caricaturer l’opposition aux OGM en ne retenant que les arguments les plus critiquables, tout en négligeant des problèmes réels et mesurables.
De bonnes intentions qui suscitent des réticences
Les deux principales motivations à l’utilisation commerciale des OGM sont la résistance aux herbicides, et la résistance aux insectes. La première application, qui occupe la majorité du marché (76 % des cultures transgéniques en 1999), a été souvent contestée, du fait qu’elle incite à l’utilisation systématique d’herbicides, néfastes pour l’environnement. Par contre, la résistance aux insectes (29 % des cultures transgéniques en 1999, certaines plantes combinant les deux propriétés) peut être a priori perçue comme un progrès écologique, puisqu’elle vise à supprimer le recours aux pesticides chimiques, qui sont néfastes pour l’environnement. Pour cette raison, certains défenseurs des OGM confèrent aux plantes résistantes aux insectes un statut d’agriculture biologique. On peut donc se demander pourquoi, même cette application « écologique » des OGM suscite tant de réticences. Dans cet article, nous nous limiterons à cette application, les plantes résistantes aux insectes. Nous commencerons par donner un bref aperçu historique, et discuterons de quelques-unes des raisons pour lesquelles l’application actuelle de cette technique peut susciter des réticences, même au sein de la communauté scientifique. Nous tenterons enfin de proposer des pistes pour une meilleure adéquation de la recherche en matière d’OGM avec les conditions de terrain.
Pour des raisons de concision, notre argumentation se limitera aux aspects biologiques de la problématique. Ceux-ci ne recouvrent toutefois qu’une petite partie des aspects essentiels à prendre en compte pour le déploiement de stratégies agricoles : économiques (coût des intrants, bénéfices escomptés), sociologiques (emploi en région agraire), géopolitiques (dépendance de pays à économie essentiellement agraire vis-à-vis des firmes semencières), sanitaires (définition de protocoles d’évaluation des risques), légaux (brevets sur les semences et les technologies), pour n’en citer que quelques-uns. Nous espérons avoir l’occasion de développer les aspects manquants dans des publications ultérieures.
L’utilisation de « Bacillus thuringiensis » en lutte biologique
La bactérie Bacillus thuringiensis (Bt) a été utilisée durant plusieurs décennies comme insecticide microbien, dans le contexte de la lutte biologique. La bactérie est épandue sous forme de spore. Chaque spore est associée à un cristal protéique, qui s’attaque aux parois digestives de l’insecte après ingestion. Une fois l’insecte tué, la bactérie quitte la forme sporulante et se multiplie. Quand le cadavre de l’insecte se dessèche, les bactéries retournent à la forme sporulante, et synthétisent le cristal toxique.
Le principal avantage de Bacillus est sa grande spécificité. Son action est bien plus limitée que celle des insecticides chimiques (dont certains sont extrêmement toxiques pour les oiseaux et poissons). La spécificité de la bactérie est telle que certaines souches de Bacillus s’attaquent aux lépidoptères, d’autres aux coléoptères, d’autres encore aux moustiques... En 1980, on avait déjà isolé une trentaine d’espèces présentant un spectre spécifique d’action. La spécificité est directement lié à la toxine, qui se présente sous des formes différentes selon les espèces.
Les gènes codant pour les protéines qui constituent la toxine ne font pas partie du génome bactérien, mais sont portés par un plasmide. Un aspect important de la toxicité est le fait qu’elle est due à un cocktail de protéines, car chaque bactérie contient plusieurs gènes, qui s’expriment simultanément, et codent pour des toxines distinctes.
L’insertion du « gène Bt » dans les plantes cultivées
En 1983, l’équipe de Marc Van Montagu (Université de Gand) isola un gène codant pour une toxine de Bacillus, et l’inséra dans le génome du tabac, conférant ainsi à la plante transgénique une résistance aux insectes. La méthode fut ensuite appliquée à d’autres espèces cultivées (principalement le coton et le maïs), et les premières utilisations commerciales commencèrent dès 1994. On utilise de façon générique l’expression « plante Bt » pour désigner les plantes transgéniques porteuses d’un gène de toxine de Bacillus thuringiensis.
En principe, l’utilisation de variétés de plantes résistantes est une des façons les plus écologiques d’éviter la perte massive des récoltes du fait d’attaques d’insectes. D’une part, ces variétés ont permis l’économie de quantités significatives d’insecticides, évitant ainsi leur effet néfaste sur l’environnement. D’autre part, dans certains cas, des variétés résistantes ont été sélectionnées pour des cultures qui, traditionnellement, ne faisaient pas l’objet d’épandage de pesticide. Dans ces cas, le bénéfice escompté est l’augmentation de productivité plutôt que la réduction de l’usage de pesticides.
On peut donc se demander pourquoi ces technologies ont soulevé tant d’objections de la part de diverses associations, lesquelles ont été, dans certains pays, relayées par une législation prohibant le déploiement de variétés transgéniques.
Un risque prévisible
La principale crainte suscitée par les plantes Bt est l’apparition d’insectes résistants. La résistance aux pesticides est un phénomène courant qui pose un gros problème pour le contrôle des insectes. Des insectes résistants aux toxines de Bt avaient déjà été détectés avant l’existence de plantes transgéniques. Toutefois, dans les conditions habituelles de contrôle biologique, les insectes sont mis en présence de la bactérie uniquement en cas d’invasion massive, et durant une période limitée. De plus, la bactérie exprime simultanément une série de toxines différentes, dont les effets se combinent. En revanche, les plantes Bt expriment de façon permanente une seule toxine, ce qui exerce une pression sélective énorme en faveur des insectes résistants.
Des précautions sabordées
Il existe des méthodes génétiques permettant d’exprimer un gène de façon sélective. On peut par exemple insérer le gène de la toxine sous contrôle d’un promoteur conditionnel, de façon qu’il ne s’exprime qu’à certains moments du développement de la plante (par exemple aux moments où les attaques des insectes sont les plus nocives), ou dans certains organes (par exemple les fruits). La mise au point de ce type de transgène à expression conditionnelle aurait permis de réduire la pression sélective, et de diminuer la probabilité d’apparition d’insectes résistants, mais demandait évidemment un temps de recherche plus important que l’insertion du gène seul. Les premières variétés commercialisées exprimaient donc la toxine de façon constitutive (dans tous les organes et durant tous les stades de développement). Malheureusement, une fois que ces variétés constitutives ont été répandues, l’intérêt des variétés à expression conditionnelle diminue, puisque les insectes résistants ont déjà été sélectionnés.
Conscientes du risque de propagation des insectes résistants, les firmes phyto-pharmaceutiques ont d’emblée proposé une stratégie pour minimiser la pression sélective, en maintenant un certain pourcentage de surface de cultures non-transgéniques, sur lesquelles les insectes pourraient survivre sans subir la pression sélective exercée par la toxine. La perte de productivité sur ces refuges devait évidemment être compensée par le gain en productivité sur les surfaces Bt. Toutefois, cette mesure ne faisait pas le bonheur des agriculteurs, qui se voyaient contraints de sacrifier une partie de leurs champs aux insectes. L’agriculteur serait donc tenté d’acheter les graines chez la firme qui conseillait le plus faible pourcentage de refuges. Pour éviter ce problème, les firmes phyto-pharmaceutiques se mirent d’accord sur le pourcentage de refuges. Quel que soit ce pourcentage, il n’en reste pas moins une frustration de l’agriculteur, qui voit une partie de son champ attaquée par les insectes. En 1999, une réglementation du département américain de l’agriculture autorisa les agriculteurs à épandre des pesticides sur les zones de refuges. Cette mesure enlève toute rationalité à l’existence même des refuges, puisqu’elle revient à recréer les conditions de pression sélective qui susciteraient la propagation rapide des insectes résistants à la toxine Bt !
L’insertion de toxines multiples
En 2001, lors d’une rencontre sur le thème « Agriculture durable dans les pays en voie de développement : définir un rôle pour les plantes transgéniques et la recherche », une représentante d’Aventis annonçait que le problème des refuges serait bientôt dépassé, car sa compagnie avait trouvé le moyen d’empêcher complètement l’apparition d’insectes résistants en insérant, non pas un, mais deux gènes de toxines Bt dans une plante.
Des simulations permettent de prévoir que, s’il suffit de 100 générations d’insectes pour qu’apparaissent des insectes résistants à une simple toxine, il en faut 10.000 pour que se développe la résistance à deux toxines. Ces simulations sont fondées sur le fait que la probabilité d’apparition d’une résistance à deux toxines indépendantes est le produit des probabilités d’apparition de chacune d’entre elles. En supposant que la probabilité pour qu’un insecte porte la résistance à une seule toxine soit de 10-6 (un individu par million), la probabilité serait de 10-12 (=10-6x10-6) pour la double résistance, de 10-18 pour la triple résistance, etc. La probabilité de résistance diminue donc de façon exponentielle avec le nombre de toxines.
Du point de vue d’un généticien, ces simulations pourraient presque porter à rire, tant elles révèlent l’ignorance (ou la négligence) complète des conditions de sélection de résistants. En effet, s’il est vrai que la sélection d’individus présentant une résistance simultanée à des toxines multiples est fortement improbable, en revanche, il suffit de présenter séquentiellement ces différentes toxines pour obtenir des insectes multi-résistants en un temps linéairement proportionnel au nombre de toxines. La raison est la suivante : s’il existe déjà des insectes résistants à la première toxine au moment du déploiement de la plante à deux toxines, ceux-ci n’auront plus qu’à développer la résistance à la seconde toxine pour acquérir la double résistance. La sélection de doubles résistants à partir de simple résistants ne coûte pas plus de temps que la sélection de résistants à la première toxine. Donc, en présentant les toxines de façon séquentielles, il suffit de 200 générations d’insectes (et non 10.000) pour sélectionner des doubles résistants. La sélection séquentielle est précisément le protocole utilisé par les généticiens depuis des décennies pour obtenir des multirésistants dans un contexte de recherche fondamentale.
En résumé, si l’on attend l’apparition des résistants à la première toxine avant de déployer les plantes à deux toxines, on favorise l’apparition rapide de doubles résistants. On peut déjà prédire la suite : quand l’apparition des insectes doublement résistants aura diminué l’efficacité des plantes à deux toxines, les firmes phyto proposeront des plantes à trois toxines, qui susciteront rapidement l’apparition de triples résistants parmi les insectes portant déjà la double résistance.
On est en droit de se demander pourquoi les firmes pharmaceutiques n’ont pas tenu compte de ces mécanismes bien connus, en combinant, dès les années 1980, plusieurs toxines de Bt dans les plantes transgéniques, avant les premières applications en champs. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’erreurs d’appréciation. Toutefois, si l’on replace les plantes transgéniques dans un contexte de marketing, il est évident qu’une stratégie de commercialisations successives d’une série de variétés, chacune surpassant la génération précédente, est plus porteuse que la mise au point d’une variété unique et plus durable. Même en s’en tenant au scénario naïf selon lequel le relâchage successif des toxines (le protocole le plus approprié pour développer rapidement des résistances multiples) relève de la maladresse plutôt que d’une politique commerciale consciente de la part des firmes phyto, les priorités commerciales et la concurrence entre ces firmes entrent en contradiction avec l’élaboration de stratégies durables pour le contrôle des insectes ravageurs. Il est donc essentiel que l’évaluation des risques écologiques soit réalisée par des organismes indépendants de ces firmes.
Dispersion des gènes de résistance aux antibiotiques
Un des problèmes soulevés par les transformations de plantes est l’utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueurs génétiques. Les gènes de résistance aux antibiotiques sont traditionnellement utilisés en biologie moléculaire pour s’assurer de l’intégration d’un transgène dans un génome-cible. Le principe est de coupler le gène à insérer (par exemple la toxine de Bacillus thuringiensis) à un gène de résistance aux antibiotiques (par exemple la résistance à la kanamycine). On peut ensuite sélectionner les cellules de plantes transformées en administrant l’antibiotique (la kanamycine) : seules les cellules ayant intégré l’antibiotique (et le gène lié) résistent au traitement.
L’utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueurs de transformation génétique est une des techniques classiques de la biologie moléculaire. Tant que cette technique est appliquée dans le contexte contrôlé d’un laboratoire, elle ne pose pas de problèmes. Malheureusement, il en va autrement quand il s’agit d’interagir avec un système aussi complexe que la production agricole et l’alimentation. Dès le début des déploiements, certaines associations de médecins ont exprimé leurs craintes que ces gènes de résistance aux antibiotiques, qui se retrouvent dans les plantes consommées par l’homme et le bétail, puissent se transmettre à d’autres bactéries, notamment des bactéries pathogènes. Ces bactéries pourraient ainsi acquérir la résistance, et rendre l’antibiotique inopérant pour le traitement d’infections bactériennes. Les bactéries résistantes aux antibiotiques sont une préoccupation majeure de la médecine actuelle et posent de gros problèmes en milieu hospitalier.
Le problème de l’utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueurs de transfert fait actuellement l’objet d’une débat entre généticiens des plantes, médecins, et microbiologistes. Si l’on se fonde sur les mécanismes connus pour le transfert horizontal de gènes, il serait extrêmement peu vraisemblable que le gène de résistance passe de la plante transgénique à une bactérie. Par ailleurs, le gène de résistance à la kanamycine est déjà répandu dans les populations bactériennes des sols, et la probabilité d’un transfert de plante à bactérie est donc négligeable par rapport aux transferts de bactérie à bactérie qui s’opèrent de toute façon déjà. Enfin, la kanamycine n’est déjà plus utilisée comme antibiotique dans nos pays, justement parce que la résistance est déjà trop répandue parmi les populations bactériennes. A posteriori, il semble donc que son utilisation ne posait pas de problèmes réels, ce qui est bien entendu rassurant. Il est cependant préoccupant de constater que ce débat voit le jour aujourd’hui seulement, alors que les plantes transgéniques sont consommées depuis neuf ans déjà.
Par ailleurs, il faut savoir qu’il existe d’autres marqueurs génétiques que les gènes de résistance aux antibiotiques. Il existe également des méthodes pour exciser le gène de résistance aux antibiotiques juste après l’avoir utilisé comme marqueur, ce qui évite de le déployer dans les cultures. Les réglementations ont été adaptées, et à l’avenir, les projets devront se fonder sur des méthodes qui ne laissent plus de marqueurs de résistance aux antibiotiques dans la plante cultivée.
On peut se demander pourquoi ces méthodes n’ont pas été utilisées d’emblée lors du développement des premières plantes transgéniques. Une possibilité est que les concepteurs des premières plantes transgéniques n’aient pas été suffisamment éveillés aux problèmes potentiels. Le biologiste moléculaire est formé à l’utilisation de méthodes adaptées aux conditions de laboratoire, mais qui ne peuvent pas forcément être transposées telles quelles de la boîte de Petri au champ. Il est regrettable que ces problèmes n’aient pas fait l’objet d’un débat préalable entre biologistes moléculaires, microbiologistes et épidémiologistes. Un tel débat aurait d’emblée écarté les gènes de résistance aux antibiotiques, et orienté les biologistes moléculaires vers d’autres marqueurs de transformation.
Effet nocif sur des espèces d’insectes non visées
Des chercheurs ont récemment découvert que l’ingestion de pollen de blé Bt était nocive pour le papillon monarque, une espèce de papillon protégée et portant une valeur symbolique importante aux États-Unis. On ne peut pas vraiment parler d’effet pervers, puisque le but de la transformation est précisément de rendre les plantes toxiques pour les insectes. On pourrait plutôt parler d’effet de bord. Il faut toutefois noter que ce problème est loin d’être limité aux plantes transgéniques : les pesticides sont beaucoup moins spécifiques que la toxine de Bacillus, et sont vraisemblablement tout aussi toxiques pour les papillons protégés, sans compter leur toxicité vis-à-vis des oiseaux et des poissons. Même dans un contexte de lutte biologique, l’aspersion de la bactérie Bacillus thuringiensis sur un champ infesté par les insectes peut évidemment provoquer des effets dommageables sur les populations d’insectes non nocifs dans le voisinage du champ. Les plantes transgéniques sont donc certainement moins nuisibles pour les espèces non visées que les moyens chimiques, ou même les moyens biologiques.
De plus, les études sur les effets de bord ont fait l’objet de contestations ultérieures, et il semblerait que le danger pour le papillon monarque ait été surévalué.
Il est assez curieux que ce soit précisément cet aspect-là, probablement assez marginal, qui ait mobilisé une bonne partie de l’opinion publique américaine contre les cultures d’OGM.
Une mise en œuvre bien maladroite
A priori, on serait tenté de considérer comme positive l’intégration des connaissances accumulées au cours de plusieurs décennies d’expérience de lutte biologique, et des méthodes de biologie moléculaire comme l’ADN recombinant, pour produire des plantes résistants aux insectes. On comprend que l’espoir de remplacer l’utilisation systématique des pesticides par la production d’une toxine naturelle ait motivé bon nombre de chercheurs académiques et que les firmes phyto aient trouvé dans cette innovation un marché prometteur. Bon nombre de biologistes considèrent que les plantes transgéniques constituent une extension des méthodes de lutte biologique (la toxine étant naturelle plutôt que synthétique), et que les technologies mises en œuvre sont mieux contrôlées que les techniques classiques de sélection des espèces cultivées (par exemple les mutagenèses par irradiation ou traitement chimique, qui reposent généralement sur des réarrangements chromosomiques beaucoup plus massifs que l’insertion d’un simple gène).
Toutefois, il nous semble que le passage de l’idée à l’application en champs a été, pour le moins, extrêmement maladroite : utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueurs de transfert, utilisation initiale d’une seule toxine, expression constitutive de cette toxine dans la plante entière, addition d’une seconde toxine après l’apparition des insectes résistants à la première...
Vers des approches systémiques ?
Quel que soit l’écosystème avec lequel on veut interagir (agriculture, foresterie...), il est essentiel de prendre en compte tous les éléments de ce système, ainsi que leurs interactions. Un des points forts de la lutte biologique et du contrôle intégré (combinaison de différentes méthodes, notamment la lutte biologique, avec recours aux moyens chimiques en cas d’infestation massive) réside dans leur approche intégrative des systèmes agraires. Ceci exige une étude approfondie des interactions entre les plantes, les ravageurs et leurs pathogènes, de sorte que le délai entre la conception d’une stratégie et le déploiement en champs prend typiquement une quinzaine d’années. Les applications actuelles des OGM résultent d’une approche intrinsèquement réductionniste, qui ont consisté à isoler un élément (la toxine) d’un système complexe (l’interaction insecte-pathogène), pour l’insérer dans un autre système complexe (la plante cultivée et son milieu de culture), sans avoir pris le temps d’évaluer la dynamique de réponse du système à cette modification.
Est-il possible de rectifier le tir ? Quels protocoles pourraient être définis pour éviter à l’avenir de retomber dans les pièges mentionnés ci-dessus, ou dans d’autres pièges moins prévisibles ? Quels seraient les acteurs compétents pour établir de tels protocoles, les évaluer, et pour veiller à leur application ? Comment combiner les multiples expertises, requises pour développer des stratégies de contrôle des ravageurs, qui respectent l’environnement de façon durable ?
Plusieurs forums se sont ouverts pour débattre de ces thèmes, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis. La politique scientifique européenne semble cependant déjà fortement engagée vers une privatisation de la recherche (brevetage des découvertes, création de « spin-off 1 », partenariat entreprise-université...), et il y a fort à craindre que les enjeux économiques et l’esprit de compétition favorisent les solutions rapides plutôt que l’élaboration, plus lente, de solutions durables.
1 Produits dérivés.
Thème : Agriculture
Mots-clés : Désinformation - OGM - SVT
Publié dans le n° 259 de la revue
Partager cet article
Agriculture
Thèmes connexes : Agriculture et alimentation bio, Alimentation
Le glyphosate est-il cancérogène ?
Le 16 février 2018
La permaculture : solution ou illusion ?
Le 7 février 2026
Animaux d’élevage : prendre en compte leurs ressentis
Le 12 décembre 2024Communiqués de l'AFIS

« Extinction Rebellion » tente d’interdire une conférence de l’Afis
Le 3 février 2023















![[Uckange (57) - Dimanche 12 octobre 2025 de 14h00 à 18h30] Fête de la science](local/cache-gd2/3e/cd6c0817ca00f0915c953501d5c863.png?1753597014)