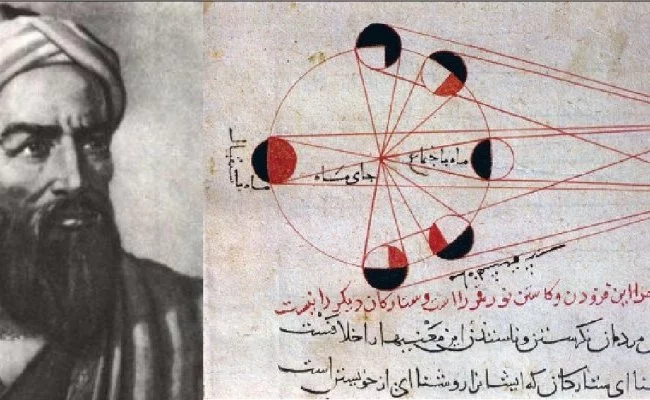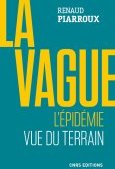Science, expertise et décision à l’épreuve de la pandémie de Covid-19
Publié en ligne le 15 juillet 2020 - Covid-19 -
Appels, pétitions et articles sont légion pour expliquer ce qu’il aurait fallu faire et ne pas faire dans la gestion de l’épidémie (qui n’est pas finie à l’heure où nous écrivons ces lignes) et pour décrire ce que devra être « le monde de demain » ou ce qu’il ne pourra plus être… Pour notre part, nous nous limiterons à une question bien plus modeste : que nous a appris cette crise sanitaire sur la science, l’expertise et ses rapports avec la décision et l’opinion publique ?
Les temps de la science et les temps de la décision
L’urgence est bien entendu, par définition, une caractéristique majeure de toute gestion de crise. Comme nous le disions dans l’éditorial du numéro 332 de Science et pseudo-sciences (avril 2020) : « Si les connaissances scientifiques sur le virus et son mode de propagation s’accumulent à une vitesse impressionnante, il reste encore de grandes incertitudes rendant bon nombre d’anticipations incertaines et révélant aussi parfois des divergences d’expertise. » Cela s’est vérifié sur d’innombrables sujets : immunisation, temps d’incubation, grande variété de symptômes, formes asymptomatiques, contagiosité des enfants, atteintes diffuses d’organes, symptômes post-infectieux, etc. La cohérence des décisions dans le temps et le besoin de réponses simples et tranchées s’accommode mal avec une science en train de se faire. Pourtant, de façon évidente, la prise de décision ne peut attendre les certitudes scientifiques.
Cette situation n’est en fait pas spécifique à cette pandémie : par essence, l’expertise scientifique nous dit l’état de la connaissance à un moment donné, et cet état n’est jamais définitif. Il faut en tenir compte et composer avec cette incertitude pour prendre des décisions éclairées. Pour le décideur, il s’agit alors de soupeser les risques et les bénéfices « à faire » et « à ne pas faire » à l’aune de l’incertitude relative (bénéfices d’ordres sanitaires, sociaux ou économiques, mais aussi médiatiques ou politiques). Par le passé, nous avons eu l’occasion de commenter des situations analogues sur de nombreux sujets (climat, agriculture, énergie, santé…) et de plaider pour l’indispensable séparation des champs : la science dit ce qui est (ou ce qu’elle en sait) mais ne prescrit pas ce qui doit être. Elle peut bien entendu éclairer des scénarios possibles. Nous avons ainsi dénoncé le fréquent mélange de genres et l’instrumentalisation ou la déformation de la science pour justifier une décision ou une position idéologique. L’épisode de pandémie de Covid-19 n’a pas fait exception. Elle a même exacerbé les passions dans un contexte où, justement, les « bonnes décisions » sont plus complexes à identifier, d’autant plus que les conséquences sanitaires indirectes peuvent être très importantes et difficiles à évaluer (voir encadré).
Ce que nous enseigne la controverse autour de l’hydroxychloroquine
Là où science et rigueur s’avèrent les meilleurs outils pour comprendre et donc agir de façon éclairée, certains ont au contraire plaidé pour un « état d’exception » dans la rigueur scientifique, masquant mal un abandon total de toute méthode et la justification potentielle de tout et son contraire.
La controverse autour de l’hydroxychloroquine promue par le Pr Didier Raoult concentre presque toutes les dérives qui auront marqué la situation. Au point de départ, il y a une hypothèse intéressante et connue depuis longtemps, mais fragile : la chloroquine présente des propriétés antivirales in vitro. Les tentatives de reproduction in vivo de ces résultats ont souvent été décevantes et l’expérimentation chez l’Homme n’a jamais été concluante ; elle a même été dangereuse dans le cas du chikungunya (lire l’article « Utilisation de la chloroquine en virologie »). Alors que la pandémie n’avait pas encore réellement gagné la France, des expériences chinoises de faible qualité sur des patients atteints de Covid-19 avaient montré des résultats contradictoires. L’examen de cette molécule s’est donc inscrit dans la logique du « repositionnement » consistant à examiner des médicaments existants, ayant déjà obtenu leur autorisation de mise sur le marché pour d’autres indications thérapeutiques. Une recherche, si elle s’avérait fructueuse, permettrait ainsi de raccourcir le temps avant la mise sur le marché d’un traitement (c’est pour cela que la quasi-totalité des recherches cliniques pour un traitement contre la Covid-19 porte sur des molécules existantes).

Au lieu de mettre en place un protocole d’évaluation rigoureux pour produire des données indiscutables et emporter l’adhésion de la communauté scientifique, le Pr Raoult, qui se dit convaincu de l’efficacité de la molécule, propose directement le traitement aux patients de son hôpital et produit des études jugées mal construites par une grande partie de la communauté scientifique et qui ne permettent de tirer aucune conclusion [1]. Il va en réalité défendre son approche essentiellement sur le terrain des médias et des réseaux sociaux, et ainsi cristalliser et incarner ce que Damien Barraud, médecin réanimateur à Metz, qualifie de « populisme médical » [2] : « Quand on communique très vite comme étant un sauveur, on prend tout le monde en otage : le gouvernement et les citoyens ; son argument d’autorité et d’expertise cherche à asseoir un appui populaire, au détriment de celui de ses pairs ; […] on dit et on donne aux gens apeurés ce qu’ils ont envie d’entendre et de recevoir : un test et une pilule. » Ce « populisme médical » s’accompagne de toutes sortes de rumeurs, de désinformation et de théories du complot pour tenter d’expliquer les réticences de la communauté scientifique (un médicament trop peu rentable pour la « big pharma », la collusion des autorités médicales avec les grands laboratoires [3]). Le « protocole du Pr Raoult » (lire l’article « Le protocole thérapeutique à géométrie variable du Pr Raoult ») est présenté comme un remède miracle qui montrerait des résultats spectaculaires dans les pays où il serait utilisé, résultats qui s’observeraient même à Marseille, où est situé l’institut du Pr Raoult [4] . Le promoteur de l’hydoxychloroquine n’hésite pas à invoquer des chiffres sans valeur, comparant par exemple le simple taux de mortalité par habitant entre Paris et Marseille pour revendiquer une meilleure prise en charge [5], faisant mine d’ignorer que l’épidémie a frappé différemment ces deux villes.
Le décideur politique est confronté à la possibilité de conséquences très diverses des décisions qu’il doit prendre. La hiérarchisation des priorités étant affaire de choix et de valeurs, elle n’entre bien entendu pas dans le champ des interventions de l’Afis. Soulignons juste ici une difficulté supplémentaire : toutes les dimensions sont imbriquées. Fermeture des écoles, confinement, isolement des personnes à risque, fermeture de certains commerces, ralentissement de l’activité économique ou réduction des échanges internationaux sont des décisions qui ont à la fois des effets économiques et sanitaires directs, mais qui sont aussi susceptibles de générer des effets secondaires en cascade, eux-mêmes d’ordre sanitaire et économique. L’accroissement de la précarité et de la pauvreté a des impacts directs en termes de pathologies et de mortalité. De même que les retards de soins ou de prise en charge pour d’autres pathologies graves (cancers, maladies cardio-vasculaires).
C’est ce paradoxe que résume le philosophe André Comte-Sponville dans un entretien accordé le 17 avril 2020 au quotidien suisse Le Temps [1] : « La médecine coûte cher. Elle a donc besoin d’une économie prospère. Quand allons-nous sortir du confinement ? Il faut bien sûr tenir compte des données médicales, mais aussi des données économiques, sociales, politiques, humaines ! Augmenter les dépenses de santé ? Très bien ! Mais comment, si l’économie s’effondre ? Croire que l’argent coulera à flots est une illusion. »
Une étude menée par l’université John Hopkins [2] évalue la mortalité indirecte de mères et d’enfants de moins de cinq ans résultant de la perturbation des systèmes de santé et de la diminution de l’accès à la nourriture pour 118 pays à revenus faibles ou intermédiaires. Selon les hypothèses retenues (disponibilité des personnels de santé, des équipements de soin, importance de la demande de soins), sur une période de six mois, de 253 500 à 1 157 000 décès d’enfants supplémentaires et de 12 200 à 56 700 décès maternels supplémentaires seraient observés. De son côté, l’OMS et l’Onusida indiquent que « si aucun effort n’est fait pour atténuer et surmonter les interruptions de services de santé pendant la pandémie de Covid-19, une interruption de six mois du traitement antirétroviral pourrait entraîner plus de 500 000 décès supplémentaires dus à des maladies liées au sida, y compris la tuberculose, en Afrique subsaharienne en 20202021 » [3].
On constate ainsi la complexité à évaluer avec précision le rapport risques/bénéfices de chacune des décisions prises.
Références
[1] Comte-Sponville A., « Laissez-nous mourir comme nous voulons ! », Le Temps, 17 avril 2020.
[2] Roberton T. et al., “Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries : a modelling study”, The Lancet Global Health, 12 mai 2020.
[3] ONU Info, « VIH/sida : les interruptions de services de santé liées au Covid-19 pourraient causer 500.000 décès de plus » , 11 mai 2020.

La méthode scientifique est jetée aux orties, jugée inadaptée et non éthique (lire l’article d’Hervé Maisonneuve « L’éthique et l’intégrité de la recherche oubliées par la pandémie de Covid-19 ? »), et un simple preprint sert de preuve, quand il ne s’agit pas tout simplement d’un article mis à disposition sur dropbox et relayé sur Twitter [6]. Rappelons qu’un preprint est un article mis en ligne par ses auteurs pour présenter les résultats d’une étude avant que ceux-ci ne soient soumis à une revue scientifique pour évaluation par les pairs. Supposés permettre une critique rapide afin d’en améliorer le contenu, les preprints ont largement donné lieu à des dérives où l’on en a vu relever plus du texte d’opinion que de la présentation des résultats d’une recherche. Ces preprints ont parfois occupé plus de place dans l’espace médiatique que les articles évalués par les pairs et publiés dans des journaux scientifiques. Notons que les revues scientifiques elles-mêmes ont parfois aussi succombé à la recherche de l’immédiateté et du scoop au détriment de la qualité de la publication (voir la chronique d’Hervé Maisonneuve « Les publications scientifiques à l’épreuve de la pandémie Covid-19 »), voire de leur sincérité, comme l’illustre l’étude sur les données de la société Surgisphere publiée par The Lancet puis rétractée par leurs auteurs.
Dès le 20 mars 2020, les Académies nationales de médecine et de pharmacie constatent que, « au vu des données actuelles de la science, […] la démonstration de l’efficacité clinique de l’hydroxychloroquine n’est pas faite à ce jour » [7] . Même son de cloche du côté américain, où les NIH (Instituts de santé américains) précisent (mise à jour du 21 avril 2020) que « les données cliniques sont insuffisantes pour recommander la chloroquine ou l’hydroxychloroquine » [8] et la Food and Drug Administration (FDA) précise que « nous ne savons pas si l’état des patients traités se serait amélioré sans le médicament », ajoutant que, « pour le savoir, il faudrait qu’un groupe de patients similaires ne reçoive pas le médicament (témoin) » [9]. À la date du 20 juin 2020, des études plus robustes commencent à produire des résultats et donnent lieu à des publications scientifiques, sans qu’un effet protecteur ou curatif de la chloroquine soit identifié. Ainsi, le 29 mai 2020, dans un avis commun, l’Académie nationale de médecine, l’Académie nationale de pharmacie et l’Académie des sciences concluent-elles [10] qu’ « aucun traitement n’existe aujourd’hui pour traiter spécifiquement la Covid-19 aux différents temps de son évolution, depuis sa prévention jusqu’à ses complications les plus sévères » (voir aussi l’analyse régulièrement mise à jour par une équipe des Hôpitaux universitaires de Genève de l’ensemble de la littérature scientifique sur ce sujet [11]). Et pire, une augmentation des complications cardiaques associée à une hausse de la mortalité est suggérée par des études observationnelles et des rapports de la pharmacovigilance [12][13]. Ceci a conduit la FDA à prendre le 15 juin 2020 une décision de révocation de l’autorisation d’urgence pour la chloroquine et l’hydroxychloroquine sur la base « des données scientifiques émergentes » montrant que ces molécules « sont peu susceptibles d’être efficaces dans le traitement de la Covid-19 » et que, « de plus, à la lumière des événements indésirables cardiaques graves en cours et d’autres effets secondaires graves potentiels, les avantages connus et potentiels de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine ne l’emportent plus sur les risques connus et potentiels pour l’utilisation autorisée. Le 17 juin, c’est l’OMS qui décide d’arrêter les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine en tant que traitement potentiel des malades de la Covid-19 hospitalisés » [14] .
Cet épisode consternant a eu des effets collatéraux délétères : discrédit porté sur l’expertise scientifique en général, difficultés à recruter des patients pour des essais de qualité visant à évaluer d’autres molécules. Ainsi, la journaliste Heidi Ledford évoque-t-elle, dans la revue Nature (24 avril 2020) un « battage médiatique qui fait dérailler la recherche de traitements contre le coronavirus » et constate que plus de cent essais cliniques visent à tester la chloroquine ou l’hydroxychloroquine et que « pouvoir rayer quelque chose comme l’hydroxychloroquine de la liste et passer à d’autres choses serait une réalisation majeure » [15]. Ajoutons que l’hydroxychloroquine aux doses proposées n’est pas d’un usage anodin concernant des patients atteints de Covid-19. Dès le 24 mars 2020, la Société de pathologie infectieuse en langue française (Spilf, société savante des infectiologues), en lien avec des associations de praticiens hospitaliers, alerte sur « ce qui s’apparente à une expérimentation en vie réelle sur la population de médicaments mal évalués dans la Covid-19 » et redoute que, à la crise sanitaire, viennent s’ajouter des « risques mettant en péril la sécurité des patients » [16].
Trop de communication et pas assez de science ?
Précisons que la communication médiatique sans attendre la validation scientifique n’a pas été l’apanage du seul Didier Raoult. Comme le note l’épidémiologiste Dominique Costagliola [17] : « Que ce soit sur le remdesivir, l’hydroxychloroquine ou le tocilizumab, les précautions d’usage n’ont pas été respectées. Dans le premier cas, c’est un laboratoire aux pratiques de lobbying agressives dans un contexte géopolitique particulier (un médicament américain une année d’élection présidentielle aux États-Unis…), dans le second les intuitions “géniales” d’un professeur ne reposant sur aucune donnée et, dans le troisième, un défaut de gouvernance dans la gestion de l’essai par l’AP-HP qui a conduit les investigateurs, qui se rêvaient peut-être déjà en sauveurs du monde, à communiquer de manière prématurée. » Face à cette situation, l’Académie de médecine a rappelé (8 mai 2020) que « la vérité scientifique ne se décrète pas à l’applaudimètre. Elle n’émerge pas du discours politique, ni des pétitions, ni des réseaux sociaux. En science, ce n’est ni le poids majoritaire ni l’argument d’autorité qui font loi » [18] . Ainsi, l’institution dénonce-t-elle les dérives dans lesquelles s’est « fourvoyée la recherche de traitements médicamenteux actifs contre la Covid-19 : trop de précipitation dans la communication, trop d’annonces prématurées, trop de discordes entre les équipes, trop de pressions de toutes sortes, mais pas assez de science ».
Quand on observe la médiatisation organisée autour des travaux de Didier Raoult, une situation comparable vient à l’esprit : les études de 2012 du Pr Séralini sur la toxicité alléguée des OGM et du Roundup sur les rats. Dans cette dernière, on retrouve une étude de très mauvaise qualité (rétractée de la revue qui l’avait initialement publiée), une médiatisation organisée (un livre paru en même temps, des interviews exclusives dans des grands magazines), une invocation de lobbies industriels accusés de sacrifier la santé publique et un appel à l’opinion publique pour demander (et obtenir) des décisions réglementaires d’interdiction. Il aura fallu plusieurs années et des millions d’euros pour que des études sérieuses soient faites, et pour constater qu’aucun des effets allégués ne pouvait être démontré [1]. Vat-on observer des conséquences durables similaires avec la controverse autour de la chloroquine ?
Références
[1] Le Bars H, « Non, les OGM ne sont pas des poisons. L’“étude choc” six ans après », SPS n° 327, janvier 2019.
À la date du 14 mai 2020, plus de 1 053 essais cliniques relatifs à la Covid-19 sont recensés dans le monde [19]. Ce chiffre est en constante augmentation. On peut s’interroger sur la pertinence d’une telle dispersion, sachant que parfois plusieurs dizaines d’essais portent sur la même molécule. En France, au 21 avril 2020, treize essais cliniques étaient recensés pour la seule hydroxychloroquine. Or, à moins de tomber sur un médicament miracle où l’effet s’observe facilement, il faut un nombre important de patients pour pouvoir conclure. La dispersion des essais devient alors un handicap car, comme le regrette l’Académie de médecine, « le manque de coordination [...] des essais thérapeutiques au niveau national, européen et international […] a généré un manque de coopération qui est en partie responsable d’essais multiples, redondants, avec de petits effectifs, qui risquent d’être non concluants » [10] (voir le témoignage du Pr Yves Hansmann « Quand une épidémie en cache une autre »). Handicap aggravé par la communication effrénée qui a entouré l’hydroxychloroquine et conduit de nombreux patients à refuser de s’inscrire dans un essai sans la garantie de se voir administrer la molécule.
La méthode scientifique en période de crise sanitaire
Comme le note le sociologue Gérald Bronner [20], « la plupart du temps, nous observons les résultats de la science lorsqu’ils sont établis et nous ne savons pas grand-chose de son processus de constitution. Donc nous ne prenons pas conscience que la méthode de la science se débat souvent dans une arborescence de possibles, avec de nombreuses incertitudes et des variables difficiles à saisir. » L’épidémie de coronavirus a permis au grand public de découvrir le processus d’évaluation par les pairs, de s’initier aux méthodes des essais cliniques et de les distinguer des études observationnelles et de comprendre les concepts de « randomisation » et de groupe contrôle (la Société française de pharmacologie et de thérapeutique a ainsi publié un excellent guide expliquant comment lire une étude scientifique [21]). Chacun a pu donner son avis, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, quant à la méthode la plus appropriée. Ce subit intérêt pourrait avoir quelque chose de positif. Malheureusement, cela a d’abord été une opportunité pour ceux qui proposaient d’abandonner la méthode scientifique ou d’en assouplir les règles afin de crédibiliser des études de mauvaise qualité. Ainsi, il ne serait pas éthique d’avoir un groupe de contrôle, l’ « urgence sanitaire » ne permettant pas de mener des études selon la méthodologie traditionnelle. Didier Raoult lui-même a théorisé cet abandon de la méthode scientifique (lire l’article de Jean-Paul Krivine « Didier Raoult contre la méthode scientifique ») pour légitimer et médiatiser des études non concluantes et proclamer l’efficacité de son remède, accusant ses collègues des autres hôpitaux qui ont refusé de le suivre de « ne pas avoir soigné les patients » [22]. Ce à quoi ont répondu plus de quarante chefs de services ou de pôles de Maladies infectieuses et tropicales, ainsi que des responsables de sociétés savantes et d’associations de médecins et de pharmaciens, dans une tribune proclamant que « la médecine n’est pas un coup de poker » (lire le texte de cet appel dans ce dossier).
En période de crise sanitaire, la méthode scientifique reste inchangée : les faits sont établis en suivant les protocoles qui fondent la démarche scientifique. On ne voit pas pourquoi pourraient émerger d’autres moyens plus efficaces d’accéder à une connaissance fiable. L’intuition, l’opinion, le « bon sens » ou le témoignage de patients ne peuvent devenir soudainement des méthodes valides pour administrer la preuve en science. Ils sont trop entachés de biais et d’erreurs de raisonnement qui font que l’on peut se tromper tout en étant de bonne foi. En ne se fiant qu’à ce type de méthodes, la moindre allégation non démontrée pourrait être proclamée vérité.
La tentation de justifier par la science
Si le processus de décision politique ne peut se réduire à l’expertise scientifique, il est cependant tentant pour l’autorité publique de se retrancher derrière celle-ci pour se dédouaner de certaines de ses responsabilités. Les rapports entre le « Conseil scientifique Covid-19 » et le gouvernement ont suscité de nombreuses discussions.
Au Royaume-Uni, ce sont les sciences comportementales qui ont été invoquées dans le cadre de la décision initiale de non-confinement, suscitant une controverse qui a secoué toute la discipline (lire l’article de Sebastian Dieguez, « Quelle place pour la psychologie scientifique dans la pandémie de Covid-19 ? »).
Soulignons seulement que la science apporte rarement des réponses tranchées et définitives. La controverse autour de l’usage des masques est emblématique de cette question (lire l’article « Pénurie et utilité des masques »).
Une quarantaine de personnalités ont signé un appel dans le journal Le Monde du 7 mai 2020 [23] pour « une coordination immédiate entre sciences et société ». Parmi les signataires, on trouve Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19, Françoise BarréSinoussi, prix Nobel de médecine et présidente du Comité analyse recherche et expertise (Care) chargé de conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests contre le coronavirus, mais aussi Hervé Chneiweiss, président du comité d’éthique de l’Inserm, Philippe Mauguin, président de l’Inrae ou encore Antoine Petit, président du CNRS. Les signataires de cette tribune appellent « à une sortie de crise par le haut grâce à un dialogue soutenu et coordonné entre sciences et société, pour une démocratie sanitaire ». Tout en reconnaissant que « l’expertise n’est pas la décision », ils entendent promouvoir « les bases d’un nouveau dialogue entre sciences, société et politique » et militent pour une « instance destinée à coordonner ce dialogue », instance qui serait placée « auprès des autorités » et ferait la promotion de la « participation citoyenne ». La leçon de cette crise sanitaire n’est-elle pas plutôt inverse ? Pour favoriser au mieux le dialogue entre la science, la société et les instances décisionnaires, ne faut-il pas d’abord faire en sorte que chacune de ces voix puisse avoir une expression indépendante ? Mélanger l’ensemble dans une entité aux contours flous ne peut que contribuer à dissoudre les données de la science dans un faisceau d’opinions et de porteurs d’enjeux qui ne favorisera ni la légitimité de la décision publique, ni le renforcement de la place et du rôle de l’expertise scientifique. Quant à la « démocratie participative », c’est un choix politique que de vouloir la privilégier sur la démocratie représentative. Et le scientifique, dès lors qu’il s’immerge dans la décision, dans la participation citoyenne, le fait en tant que citoyen.
Cette pandémie nous rappelle, s’il en est besoin, que l’Homme continue à vivre dans une nature qui n’est ni bienveillante, ni accueillante (ni l’inverse d’ailleurs, la nature n’a pas d’intention, elle se contente d’être...). De nombreux habitants de par le monde le constatent quotidiennement. Le passage du virus de la chauve-souris à l’Homme en passant par un hôte intermédiaire (hypothèse à ce jour la plus plausible) a été favorisé par l’existence d’un commerce d’animaux vivants sur des marchés où la réglementation sanitaire est quasi inexistante. Pour la géographe Sylvie Brunel, « les sociétés développées ne consomment pas d’animaux sauvages » [24]. Il ne faut pas oublier, en effet, comme le rappelle Peter Ben Embarek, expert de l’OMS en matière de sécurité sanitaire des aliments et de maladies animales [25], que « les marchés d’animaux vivants sont essentiels pour fournir de la nourriture et des moyens de subsistance à des millions de personnes dans le monde » et que seul un accès facilité à l’alimentation (qui s’accompagnera toujours de meilleurs contrôles sanitaires) constituera une prévention durable contre certains risques de zoonose.
Nombreux sont ceux qui voudront voir dans la crise épidémique la confirmation des alarmes qu’ils avaient lancées auparavant ; les « je vous l’avais bien dit » se multiplient. Les tribunes dans les grands journaux et les pétitions en lignes se succèdent pour que, si l’on veut éviter « que cela ne se reproduise », si l’on souhaite que le « monde d’après » soit différent, il doit correspondre à celui qu’ils nous préconisaient avant la pandémie. Pour certains, la pandémie serait une sorte de punition divine : « Nous recevons une sorte d’ultimatum de la nature […] qui cherche à tester notre détermination » (Nicolas Hulot sur BFMTV le 22 mars 2020). D’autres voient au contraire la main de l’Homme derrière cette pandémie, avec un virus échappé d’un laboratoire à Wuhan (lire l’article de Damien Goutte-Gattat « Le coronavirus a-t-il été créé en laboratoire ? »), voire fabriqué dans ce laboratoire (lire l’article « Le Pr Luc Montagnier et la rumeur du virus fabriqué dans un laboratoire »). Pour l’association « Nous voulons des coquelicots » qui milite pour l’interdiction des pesticides dits de synthèse, « les parallèles [sont] évidents entre la crise du coronavirus et l’expansion sans fin des pesticides » [26].
Loin de ces récupérations idéologiques, la science s’intéresse bien sûr à « l’implication des enjeux environnementaux dans ce type de phénomènes et [aux] conditions qui auraient permis, sinon de l’empêcher, du moins de mieux l’anticiper et d’en réduire les conséquences, pour mieux se prémunir lors d’une prochaine crise similaire » [27] (lire l’article « Covid-19 et biodiversité » qui reproduit des extraits du rapport du 15 mai 2020 de la Fédération pour la recherche sur la biodiversité sur ce sujet). Les modalités des interactions entre l’Homme et la biodiversité jouent évidemment dans les risques épidémiologiques associés à certaines zoonoses, et certains facteurs sont identifiés (déforestation, urbanisation, développement des voies de communication), mais d’une façon complexe que l’on ne saurait réduire à des humains prédateurs par essence, sauf à estimer que l’Homme est un intrus sur Terre.

La généralisation des échanges internationaux a favorisé la dissémination rapide du virus et l’épidémie chinoise est devenue pandémie en quelques semaines, quand la grande peste du Moyen Âge avait mis plusieurs années pour couvrir la majeure partie de l’Europe et du pourtour méditerranéen. Mais dans le même temps, la science moderne s’est développée. La Chine a été capable de séquencer le virus en quelques jours et les connaissances acquises sur la maladie se sont accumulées au niveau mondial à une vitesse extraordinaire, se poursuivant dans la recherche d’un vaccin. S’il ne faut pas occulter les rivalités, les enjeux économiques et les retombées variables suivant le niveau de développement de chacun des pays ou le niveau de vie des personnes, c’est bien la science et la médecine qui permettent de comprendre la pandémie et d’aider à élaborer les réponses adaptées. Et c’est également la science qui permet de mieux comprendre la dynamique des zoonoses, le rôle des activités humaines et la manière de réduire les risques tout en permettant à une population qui devrait atteindre près de dix milliards d’individus en 2050 d’avoir accès à une alimentation suffisante et de qualité, ainsi qu’aux autres principaux services indispensable à la vie (eau, soins, électricité, etc.).
Enfin, la pollution environnementale est également accusée d’avoir favorisé la propagation du virus, ou tout au moins renforcé sa mortalité. Faute de place, et compte tenu des connaissances encore très partielles sur le sujet, c’est dans le prochain numéro de SPS que ce thème sera abordé.
Conclusion
Dans l’éditorial de notre numéro d’avril 2020, nous nous interrogions : « L’après-coronavirus pourrait-il signifier une réhabilitation de l’expertise scientifique et plus de science et de rationalité dans la décision publique ? » Un certain optimisme pouvait être de mise quand nous constations que c’est « vers des experts reconnus que les micros se sont jusque-là préférentiellement tournés, à la différence d’autres sujets médiatisés où des “experts” autoproclamés issus de mouvements associatifs partisans occupent l’espace médiatique ». Il faut reconnaître que cet optimisme a dû être tempéré. Pourtant, la réhabilitation de la place de la science dans la société reste centrale. Cela passe par moins de politique en science et par le respect de son intégrité.
1 | « Coronavirus : la controverse autour de l’hydroxychloroquine. La science ne se fait pas sur YouTube, Twitter ou Facebook », communiqué de l’Afis, 27 mars 2020. Sur afis.org
2 | « Covid-19. Damien Barraud : “C’est de la médecine spectacle, ce n’est pas de la science” » (visible sur ce site, 11 avril 2020, lamarseillaise.fr
3 | « Un “collectif de citoyens pour FranceSoir” », « Seules sont perdues d’avance les batailles qu’on ne livre pas », 28 mai 2020, francesoir.fr.
4 | « Covid-19 : Marseille 5 – Paris 1 juste les chiffres », 20 mai 2020, francesoir.fr.
5 | « Comparaison des courbes épidémiques selon villes et pays », 19 mai 2020, vidéo sur le site de l’IHU Méditerranée
6 | Message de Didier Raoult sur Twitter relayant une étude brésilienne, 18 avril 2020.
7 | « Communiqué des Académies nationales de médecine et de pharmacie sur les traitements à base d’hydroxychloroquine dans le cadre de la pandémie de Covid-19 », 20 mars 2020.
8 | National Institutes of Health, “Potential Antiviral Drugs Under Evaluation for the Treatment of COVID-19”, 21 avril 2020.
9 | Food and Drug Administration, “Frequently Asked Questions on the Emergency Use Authorization (EUA) for Chloroquine Phosphate and Hydroxychloroquine Sulfate for Certain Hospitalized COVID-19 Patients”. Sur fda.gov (consulté le 29 mai 2020).
10 | « Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19 : Cibles thérapeutiques, exigences méthodologiques, impératifs éthiques », Avis tri-académique (Académie nationale de médecine, Académie nationale de pharmacie, Académie des sciences), 29 mai 2020.
11 | Samer C et al., « Chloroquine, hydroxychloroquine et Covid-19 : Évaluation pharmacologique », Service de pharmacologie et toxicologie cliniques, Hôpitaux universitaires de Genève. Sur hug-ge.ch
12 | Réseau français des Centres régionaux de pharmacovigilance, « Chloroquine et hydroxychloroquine – Point d’information à destination des professionnels de santé », 22 mars 2020.
13 | Lee S et al., “Cardiovascular Toxicities Associated with Hydroxychloroquine and Azithromycin : An Analysis of the World Health Organization Pharmacovigilance Database”, Circulation, 22 mai 2020.
14 | Food and Drug Administration, “Hydroxychloroquine or Chloroquine for COVID-19 : Drug Safety Communication – FDA Cautions Against Use Outside of the Hospital Setting or a Clinical Trial Due to Risk of Heart Rhythm Problems”, 24 avril 2020.
15 | Ledford H, “Chloroquine hype is derailing the search for coronavirus treatments”, Nature, 24 avril 2020, 580 :573.
16 | « Prise en charge des infections à coronavirus SARS‐CoV-2 : l’utilisation de chloroquine et hydroxychloroquine doit être encadrée d’urgence », communiqué du 24 mars 2020.
17 | Costagliola D, « Traitements du Covid-19 : “Nous sommes dans une situation proche du délire” », Le Figaro, 7 mai 2020.
18 | Académie nationale de médecine, « Recherche clinique et Covid-19 : la science n’est pas une option », communiqué du 8 mai 2020.
19 | Global Coronavirus COVID-19 Clinical Trial Tracker.
20 | Bronner G, « La science ne peut se substituer au politique », Le Point, 21 avril 2020.
21 | « Je ne sais pas comment simplement interpréter un article présentant les résultats d’une étude clinique. Pouvez-vous m’aider ? », Foire aux questions, question numéro 136, Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Sur sfpt-fr.org
22| « Covid-19 : Quelles leçons doit-on tirer de l’épidémie ? », vidéo de Didier Raoult, 12 mai 2020. Sur youtube.com
23 | « Covid-19 : Appel pour une coordination immédiate entre sciences et société », Le Monde, 7 mai 2020.
24 | Brunel S, « La nature livrée à elle-même n’est pas l’amie du genre humain », Le Figaro, 17 avril 2020.
25 | “Live Animal Markets Should Be Improved Not Outlawed, Say WHO”, Time, 8 mai 2020.
26 | « Le coronavirus et les coquelicots », Association Nous voulons des coquelicots, 13 mars 2020.
27 | Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Mobilisation de la FRB par les pouvoirs publics français sur les liens entre Covid-19 et biodiversité », version du 15 mai 2020.
L’introduction récente du terme « Covid-19 » s’est accompagnée d’une indécision sur le genre à utiliser en français. En peu de temps, l’emploi du masculin est devenu majoritaire dans le langage courant et les médias ; il a été adopté par nombre d’acteurs de la santé tels que Santé publique France ou l’Institut Pasteur (qui parle cependant le plus souvent de « la maladie Covid-19 »). D’autres institutions, en revanche, utilisent le féminin (OMS, site Éduscol du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse) ; c’est également ce que font le gouvernement et les médias canadiens, suite à une recommandation émise par l’Office québécois de la langue française. Le 7 mai, l’Académie française s’est prononcée pour l’usage du féminin. Cette incertitude entre masculin et féminin a conduit le dictionnaire Robert, dans sa dernière édition, à reconnaître… les deux genres. « Covid-19 » est l’écriture française de l’acronyme anglais COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) qui signifie « maladie à coronavirus de 2019 ». Il s’agit d’une maladie qui est causée par le virus SARS-CoV-2, autre acronyme anglais (Severe Acute Respiratory
Syndrom Coronavirus 2) signifiant « coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère ». Qu’ils soient français ou d’origine étrangère, les acronymes prennent, sauf exception, le genre qu’a en français le mot de base (ou « noyau du syntagme ») qui les compose. S’agissant de la maladie pour Covid-19 et du virus pour SARS-CoV-2, il apparaît ainsi logique de dire « la » Covid-19 et « le » SARS-CoV-2. Un intérêt de cette dénomination est précisément d’éviter la confusion entre la maladie et le virus qui en est la cause, l’amalgame étant souvent fait dans le langage courant.
Ce sont ces raisons qui ont poussé SPS à adopter dans ce numéro l’usage du féminin. Certes, on pourra objecter qu’une langue est façonnée par son usage et que celui-ci imposera vraisemblablement le masculin, déjà bien installé. Mais concernant un sujet sur lequel la communication s’avère souvent confuse, il nous a semblé utile d’être le plus rigoureux possible.
Secrétariat de rédaction de SPS
Publié dans le n° 333 de la revue
Partager cet article
L'auteur
Jean-Paul Krivine

Rédacteur en chef de la revue Science et pseudo-sciences (depuis 2001). Président de l’Afis en 2019 et 2020. (…)
Plus d'informationsCovid-19

Covid-19, hydroxychloroquine et traitement médiatique
Le 9 janvier 2023
Mauvaises conduites et Covid-19
Le 11 octobre 2022
Restaurer l’intégrité scientifique après la crise Covid-19
Le 4 octobre 2022Communiqués de l'AFIS



















![[16 juin 2022 - Paris] Covid-19 : Deux ans d'épidémie, qu'avons-nous appris ?](local/cache-gd2/0f/33c69087dceb597afeb0e562895a7f.jpg?1724967507)