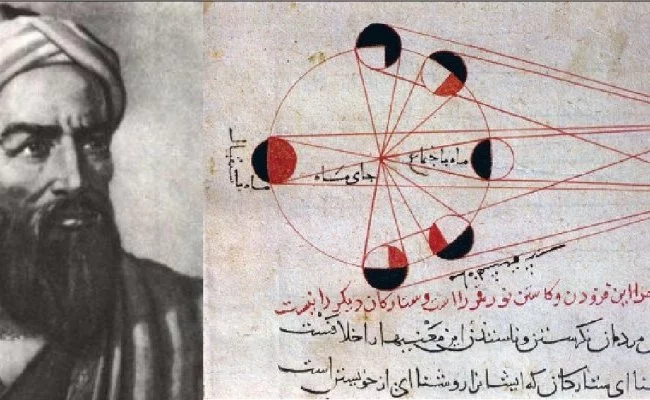Militer pour la science
Publié en ligne le 19 novembre 2019Les mouvements rationalistes en France (1930–2005)
Sylvain Laurens
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2019, 244 pages, 21 €

L’auteur, sociologue, a pris le parti d’aborder le rationalisme sous l’angle concret de ses manifestations sociales et politiques, de leur évolution dans un contexte historique mouvant. Ainsi, il ne s’agit pas de discuter le concept même de rationalisme, ni le lien entre science et raison ; l’objet de l’étude est un rationalisme identifié comme un militantisme « pour la science » effectué au sein de quelques organisations importantes. La courbe historique de ce rationalisme moderne (la période couverte commence dans les années 1920 et s’achève à la fin des années 2000) y est divisée en six grandes trajectoires consécutives mais se chevauchant parfois, traitées en autant de chapitres. Les sources convoquées sont multiples : entretiens personnels avec des acteurs du rationalisme, lecture et analyse de publications issues de ce mouvement (y compris Science et pseudo-sciences), consultation d’archives internes ou privées, références savantes (concernant notamment les trajectoires des différents mouvements politiques et l’évolution socio-économique des métiers scientifiques).
Le plus clair de son histoire, le rationalisme militant a eu partie liée, en France, avec quelques grandes tendances de la gauche (mouvements laïcs et francs-maçons, socialisme, communisme marxiste). L’interaction complexe entre ces mouvements politiques et l’engagement dans les organisations rationalistes est décrit avec une grande précision. Ainsi le rapport entre le Parti communiste français (PCF) et l’Union rationaliste (UR) a pu osciller entre une symbiose, une ambivalence critique, voire une quasi-dissidence lorsque l’UR a servi de refuge, pendant les durcissements de la guerre froide, à des scientifiques en délicatesse avec les autorités du Parti. L’affaire Lyssenko, notamment, a provoqué moult remous dans une UR tiraillée entre les injonctions du Parti pour adopter une position pro-soviétique et les scrupules moraux et scientifiques des responsables de l’UR face à ce qui était manifestement une fraude scientifique 1.
Mais le rationalisme, majoritairement porté dans l’arène militante par des professions scientifiques, a aussi été modelé par l’évolution de la « production des savants », de l’organisation bureaucratique du travail scientifique, de la massification du recrutement des personnels scientifiques à partir des années 1930 et surtout des années 1960, du pilotage politique et économique de l’activité scientifique (par exemple l’État-stratège de type gaulliste, puis la mutation néo-libérale initiée dans les années 1980). Les servitudes des chercheurs et ingénieurs changent, ce qui induit des évolutions dans les priorités poursuivies par les militants issus de ces milieux.
Ces mutations posent parfois de graves problèmes aux organisations rationalistes qui s’avèrent incapables d’y faire face en conciliant fidélité aux principes historiques et renouvellement du corps militant. L’Union rationaliste dépérit progressivement avec l’affaiblissement du PCF et des vieux réseaux militants, tandis que l’Agence (devenue plus tard Association) française pour l’information scientifique (Afis), créée en 1968 par Michel Rouzé 2, s’avère être par ses choix thématiques (lutte contre le charlatanisme et les pseudo-sciences) « le compromis le plus acceptable pour tous les pôles de la galaxie rationaliste » (p. 143). Puis, pendant les années 1970 à 1980, la fin de l’hégémonie sur le rationalisme de réseaux susmentionnés (communisme, franc-maçonnerie) implique à la fois un déplacement et un certain rétrécissement des préoccupations ; ainsi passent au second plan les débats sur la « responsabilité du savant » ou la critique à faire de certains usages de la science (l’exemple type étant la bombe atomique), rétrécissement qui trouve son paroxysme dans un militantisme « zététique » uniquement préoccupé par la réfutation expérimentale des sornettes (p. 182). Certains militants – dont on ne saisit pas précisément la représentativité – voudraient que le rationalisme soit plus partial en faveur de préoccupations « écologistes » (comme la critique du recours à l’énergie nucléaire). Ces inflexions et ces désaccords suscitent quelques débats houleux largement mis en avant dans l’ouvrage. L’auteur souligne que les sciences sociales sont devenues les parents pauvres du rationalisme, principalement convoquées pour expliquer la diffusion des croyances irrationnelles (p. 232). Mais ces nouvelles approches du rationalisme visent aussi plus efficacement le grand public, alors que l’UR a pu fonctionner comme un « club à la mondanité intellectuelle relativement fermée » (p. 31) aggravé par un recrutement quasi familial de ses dirigeants (le livre prend soin d’afficher, au fil des chapitres, les bureaux de direction successifs de l’UR).
Ce ne sont là que quelques-uns des mécanismes socio-historiques étudiés dans l’ouvrage. Le panorama est détaillé, proposant des extraits d’entretiens et des détours biographiques indispensables pour apprécier les ressorts parfois personnels de l’évolution de structures dont les militants actifs sont toujours fort peu nombreux. L’écriture est très claire, presque entièrement dénuée de jargon sociologique, ce qui fait de ce livre une lecture facile – et passionnante – pour le profane.
Nous émettrons tout de même quelques critiques. On s’étonne des dix pages (p. 163-173) entièrement consacrées à Michel Tubiana, scientifique et essayiste aux positions tranchées, mis en avant comme une sorte de porte-drapeau des nouvelles tendances du rationalisme. Or il n’est affilié à aucune des organisations citées ; cela constitue une entorse à la méthodologie choisie. À l’inverse, on regrette un certain nombre d’ellipses ou d’insuffisances. Ainsi les militants rationalistes « se présentent comme des porte-paroles de tous les chercheurs » (p. 14), sans qu’on sache s’il s’agit d’une revendication des militants ou d’une interprétation de l’auteur, ni sur quels éléments se fonde cette présentation. Les rationalistes des années 1970-1980 seraient « entraînés par le discours de certains patrons de la bureaucratie scientifique et par des effets d’audience » (p. 182), mais l’« entraînement » n’est pas étayé. L’expression « épistémologie de marché » (p. 197), affichée en tête de chapitre, n’est pas explicitée alors que son sens est vague et propice aux mésinterprétations 3. Lorsque l’auteur analyse la part relative des différents sujets dans Science et pseudo-sciences (p. 204), on aurait aimé avoir accès à des tableaux détaillés, par exemple en annexe. L’auteur affirme que l’Afis a « des positions très ambivalentes » sur le climat (p. 212), en s’appuyant sur deux ou trois articles sortis de leur contexte (les dossiers où ils ont été publiés) et en ignorant les prises de position officielles de l’association. Certains adhérents de l’Afis seraient « proches de la mouvance libérale voire libertarienne » (p. 212), mais l’influence éventuelle de ces engagements sur le discours de l’association n’est pas analysée – de même pour les militants issus du trotskysme –, au contraire du travail réalisé à propos du PCF. Il manque aussi, concernant l’Afis, une analyse de la composition des bureaux ou conseils d’administration successifs qui aurait pu mettre en lumière les déterminations sociologiques à l’œuvre dans les orientations de l’association.
Par ailleurs, pour la dernière décennie (les années 2000), l’ouvrage se focalise sur une analyse de l’Afis fondée en part importante sur des témoignages de « déçus » dont on peut douter qu’ils donnent une image juste de l’évolution de cette association et de ses centres d’intérêt. Un facteur maître de cette évolution, à savoir l’émergence et le succès médiatique de campagnes pseudo-scientifiques orchestrées non plus par des vendeurs de camelote ésotérique, mais par des groupes militants se réclamant de l’écologie politique, est passé sous silence. Enfin, si l’effilochement du lien entre le rationalisme et les mouvements de gauche est bien analysé sous son rapport quantitatif (le déclin et le vieillissement des effectifs du PCF, notamment), le versant qualitatif de ce désamour n’est pas abordé. Or la gauche communiste et socialiste, qui s’appuyait sur le rationalisme pour défendre une transformation sociale fondée sur le progrès (scientifique, technique, industriel), est passée à un discours faisant désormais la part belle à l’utopie, à l’imaginaire ou au simple rêve (comme en témoigne le slogan « rêve générale » (sic) que l’on retrouve régulièrement dans les manifestations dites « de gauche » 4). Le rationalisme, de point d’appui, devient pour ces postures un boulet, un rabat-joie.
Malgré tout, l’auteur a réalisé ici un travail extrêmement louable. La perspective adoptée est féconde et fera prendre conscience au lecteur, s’il ne fait pas partie des bataillons les plus âgés du rationalisme, des évolutions d’un courant qui semble parfois amnésique quant à ses propres mutations historiques.
1 Voir sur le sujet : « L’affaire Lyssenko, ou la pseudo-science au pouvoir », Yann Kindo, SPS n° 286, (juillet 2009).
2 Michel Rouzé, journaliste militant proche du socialisme puis du communisme, était lui-même investi dans l’Union rationaliste. Voir : « Un demi-siècle de combats contre les pseudo-sciences (1968-2018) », Jean-Paul Krivine, SPS n° 326, (octobre 2018).
3 Elle semble d’ailleurs promise à un certain avenir médiatique, puisqu’elle est reprise tour à tour par Libération (« Peut-on croire au Bronner ? », Simon Blin, 3 avril 2019) et Le Monde ( « La science, objet de méfiance », Pierre-Cyrille Hautcœur, 22 mai 2019).
4 Lire par exemple « Rêve générale dans les cortèges », François Wenz-Dumas, Libération, 29 janvier 2009.
Publié dans le n° 331 de la revue
Partager cet article
Auteur de la note
Rationalisme

Une responsabilité morale du scientifique ?
Le 7 mars 2024
Apolitique ?
Le 18 octobre 2023









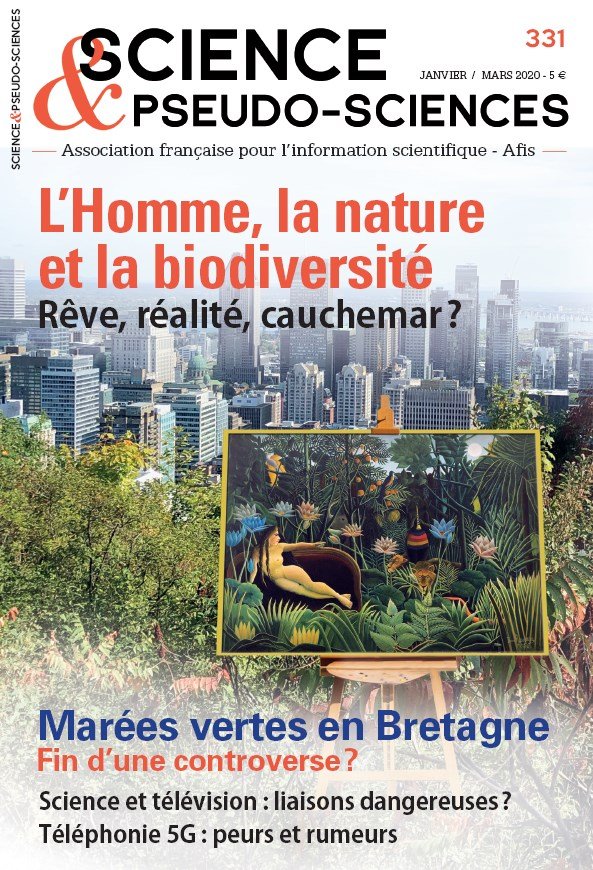





![[Quimper - Jeudi 8 juin 2023] Comment le citoyen peut-il se forger son opinion sur des sujets complexes ?](local/cache-gd2/f4/9ee76130abb54d16cc2bf0302a1e9d.png?1685597742)
![[*Reporté* Saint-Étienne – mardi 28 mars] Science et pseudo-sciences](local/cache-gd2/7c/4a72bb966182f830bae8d21777041d.jpg?1681568330)