Bruno Latour et la vérité en science
Publié en ligne le 1er juin 2023 - Rationalisme -
Nous publions ici une adaptation (revue par l’auteur) d’un texte publié en mai 2020 par Alain Policar dans la revue numérique Telos sous le titre « Bruno Latour, le virus et la vérité ».
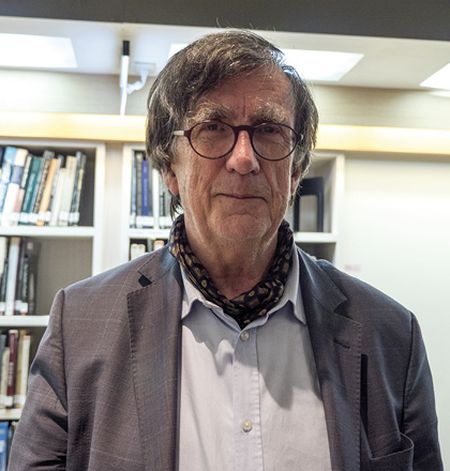
Connu pour ses travaux en sociologie des sciences, Bruno Latour a adhéré au « constructivisme », la « philosophie » selon laquelle l’activité scientifique ne peut être séparée des cadres sociaux au sein desquels elle se réalise et où toute « vérité » scientifique est une construction, ce qui signifie qu’elle ne saurait découler de la démonstration, de la preuve publique, comme l’on pourrait être tenté de le croire.
La vérité est-elle soluble dans le social ?
Selon Bruno Latour, ce qui importe, dès lors qu’on s’intéresse aux énoncés scientifiques, ne serait plus la question de leur vérité mais celle de la fabrication et de la négociation du sens. Dans cette perspective, les catégories d’objectivité et d’exactitude deviennent des catégories locales, des productions historiques. On comprend qu’il convient alors de remplacer le jugement habituel selon lequel les savoirs scientifiques circulent en raison de leur universalité par l’évidence contraire selon laquelle ils sont décrits comme universels précisément parce qu’ils circulent. Les sciences ne seraient donc plus des activités cognitives progressant par expériences et démonstrations. Toujours selon ce point de vue, la classique distinction entre la logique de la justification (le processus qui consiste à prouver une hypothèse) et la logique de la découverte (le processus qui conduit à émettre une hypothèse) n’est pas pertinente, puisque les concepts étudiés et les moyens mis en œuvre lors des expériences ne peuvent être séparés du social et du politique. L’autorité acquise dans la vie sociale peut donc influencer la détermination même de ce qui sera considéré comme un résultat scientifique.
Cette approche refuse toute idée d’une quelconque autonomie des connaissances scientifiques par rapport au social. Si la vérité dépendait exclusivement du social, le scientifique deviendrait un simple constructeur de modèles, la référence à une nature dont il faudrait expliquer le comportement étant sans objet. C’est bien ce qu’affirme Bruno Latour, avec une constance méritoire (voir encadré « De quoi est mort le pharaon Ramsès II ? ») quand il évoque en 2020 la pandémie de Covid-19 : « Le virus n’a rien à voir avec la “nature”. Quand on voit la diversité incroyable des réactions au virus, que ce soient les corps individuels, les corps sociaux, les corps nationaux, on s’aperçoit que l’image d’un événement de la nature qui tomberait de l’extérieur et uniformément sur les pauvres humains n’a rigoureusement aucune espèce de sens » [1]. De l’interrogation (légitime) sur la manière dont a été pensée la séparation entre nature et culture, on passe donc à l’inexistence d’une réalité naturelle du virus.
Héritière de Thomas Kuhn (1922-1996) et, surtout, de Paul Feyerabend (1924-1994), une partie de la sociologie des sciences contemporaines attribue dans l’explication des résultats scientifiques une place prépondérante, pour ne pas dire unique, aux critères externes, tout particulièrement au poids des logiques financières, politiques et technologiques. Cette sociologie adhère implicitement à l’idée que le chercheur est animé, pour l’essentiel, par des intérêts professionnels à court terme. S’il ne fait guère de doute que les scientifiques recherchent une rétribution de leurs travaux et une reconnaissance sociale, il est plus difficile d’admettre qu’ils construisent une réalité en fonction de leurs convictions personnelles. Si seuls les facteurs de détermination externe jouaient un rôle, il serait difficile de décider quelles observations sont susceptibles de départager des théories scientifiques rivales. C’est pourtant la voie choisie par B. Latour.

Dans La Vie de laboratoire [2], il défend une anthropologie symétrique : « Ou bien il est possible de faire une anthropologie du vrai comme du faux, du scientifique comme du préscientifique, du central comme du périphérique, du présent comme du passé, ou bien il est absolument inutile de s’adonner à l’anthropologie qui ne sera toujours qu’un moyen pervers de mépriser les vaincus tout en donnant l’impression de les respecter [...]. Non seulement il faut traiter dans les mêmes termes les vainqueurs et les vaincus de l’histoire des sciences, mais il faut traiter également dans les mêmes termes la nature et la société. »
« Où se trouvaient donc les objets que découvrent les savants “avant” cette découverte ? Si l’on diagnostique par exemple au Val de Grâce que Ramsès est mort de la tuberculose, comment a-t-il pu décéder d’un bacille découvert par Robert Koch en 1882 ? Comment, de son vivant, pouvait-il boire de la bière fermentée par une levure que Pasteur (grand adversaire de Koch) ne mit en évidence que vers le milieu du XIXe siècle ?
La réponse de bon sens – mais elle n’a, comme on va le voir, que l’apparence du bon sens – consiste à dire que les objets (bacilles ou ferments) étaient déjà là depuis des temps immémoriaux, et que “nos savants” les ont simplement tardivement découverts : ils ont soulevé le voile derrière lequel ces petits êtres se cachaient. L’humanité s’aperçoit rétrospectivement qu’elle avait agi jusqu’ici dans l’obscurité. Dans cette hypothèse, l’histoire des sciences n’a qu’un intérêt fort limité. Elle ne fait que rappeler les obstacles qui ont empêché les savants de saisir plus tôt et plus vite la réalité qui restait, pendant ce temps, immuable. Les savants jouent à cache-tampon, et les historiens leur disent simplement, comme aux enfants : “Vous brûlez !”, “Vous refroidissez !”. Il y a une histoire de la découverte du monde par les savants, mais il n’y a pas d’histoire du monde lui-même.
La réponse la plus radicale – mais elle n’a, comme on va le voir, que les apparences de la radicalité – consiste à dire, au contraire, que Ramsès II est bien tombé malade “3 000 ans après sa mort”. Il a bien fallu attendre 1976 pour donner une cause à sa mort, et 1882 pour que le bacille de Koch puisse servir à cette attribution. Avant Koch, le bacille n’a pas de réelle existence. Avant Pasteur, la bière ne fermente pas encore grâce à la Saccharomyces cerevisiae. Dans cette hypothèse, les chercheurs ne se contentent pas de découvrir : ils produisent, ils fabriquent, ils construisent. L’histoire inscrit sa marque sur les objets des sciences, et pas seulement sur les seules idées de ceux qui les découvrent. Affirmer, sans autre forme de procès, que le pharaon est mort de la tuberculose découverte en 1882, revient à commettre le péché cardinal de l’historien, celui de l’anachronisme. »
Latour B, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », in Chroniques d’un amateur de sciences, Presses des Mines, 2006.
Cette vision de la recherche scientifique est en adéquation avec l’idée que le sens et les preuves seraient socialement négociés entre scientifiques. Certes, il n’est pas question de nier l’existence de controverses scientifiques. Mais celles-ci s’expliquent par le fait que les théories sont « sous-déterminées » par les faits : plusieurs théories peuvent rendre compte de façon cohérente d’un ensemble de faits et de nouvelles données sont nécessaires pour les départager.
Le refus de la distinction entre une preuve expérimentale et une conviction mène tout droit au relativisme épistémologique, c’est-à-dire à l’idée qu’aucune connaissance ne peut être objective et qu’il s’agit toujours d’une construction. En identifiant la vérité au consensus, il est douteux que la sociologie des sciences échappe à ce que le philosophe et sociologue Raymond Boudon (1934-2013) appelle un paradoxe de composition, à savoir le fait que ce qui est vrai dans le court terme peut devenir faux dans le long terme. L’analogie que celui-ci fait avec l’enquête judiciaire est éclairante. En effet, tant que l’enquête se prolonge, « les partisans des deux théories T et T’ en présence ont bien souvent de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons ni objectives ni pour autant arbitraires, d’adhérer à l’une ou à l’autre » [3]. De même, en science, cas banal, « la préférence du chercheur pour une théorie T apparaît comme fondée en t sur des raisons subjectives et en t+k sur des raisons objectives » [3]. Que l’on ne puisse toujours déterminer la vérité tout de suite n’autorise pas à conclure qu’il n’existe pas de vérité.
La vérité en tant que norme
La position sceptique consistant à douter de tout et à n’admettre aucune vérité représente la philosophie spontanée de notre temps. La responsabilité du philosophe Michel Foucault (1926-1984) dans cette funeste orientation n’est pas douteuse. S’il convient de ne pas sous-estimer l’apport de ce dernier dans le domaine de l’archéologie des connaissances, c’est-à-dire dans celui des conditions de production des discours sur la sexualité, la folie ou la prison, on ne doit précisément pas confondre ces questions des conditions d’existence du savoir avec celles des conditions de vérité. Dans un entretien de 1977, Foucault affirme que « la “vérité” est liée circulairement à des systèmes de pouvoir qui la produisent et la soutiennent, et à des effets de pouvoir qu’elle induit et qui la reconduisent » [4]. Dès lors, ce ne sont pas les faits qui nous contraindraient, mais le « régime de vérité » 1 de la société à laquelle nous appartenons. Ce raisonnement est typique du constructivisme de la justification pour qui la validité d’une preuve est une convention sociale. Dans l’épistémologie de Foucault, il n’existe aucune place pour la distinction entre être vrai et être tenu pour vrai. Il est pourtant essentiel de ne pas confondre, comme le souligne le philosophe Jacques Bouveresse (1940-2021), le caractère historiquement déterminé des moyens dont nous disposons pour décider si une proposition est vraie ou fausse avec « la vérité ou la fausseté de la proposition, qui peut très bien être déterminée sans que nous y soyons pour quelque chose » [5].
Ce qu’un philosophe des sciences se devrait d’expliquer prioritairement, c’est la prépondérance des convergences scientifiques. La question fondamentale est bien, comme l’écrit Pierre Jacob, « de comprendre comment les scientifiques finissent par s’accorder pour décider quelles observations sont susceptibles de départager des théories scientifiques rivales et pour déterminer quelles théories doivent être éliminées » [6]. La sociologie empirique des sciences promue par Bruno Latour soutient que les raisons qu’ont les scientifiques d’adopter une théorie scientifique ne sont pas, ipso facto, des raisons de la croire ou de la tenir pour vraie. À l’inverse, il est nécessaire de défendre l’idée que la vérité est une norme, c’est-à-dire ce vers quoi tend l’enquête. Ainsi que l’affirme le philosophe Pascal Engel, il est impossible de fournir une théorie de la justification de nos croyances sans faire appel au concept de vérité [7].
Le relativisme épistémologique défendu par Bruno Latour a des conséquences politiques fort dommageables : « Si les puissants ne peuvent plus critiquer les opprimés parce que les catégories épistémiques fondamentales sont inévitablement liées à des perspectives particulières, il s’ensuit également que les opprimés ne peuvent plus critiquer les puissants. Voilà qui menace d’avoir des conséquences profondément conservatrices » [8]. Il est certainement plus aisé de défendre les valeurs de solidarité, de tolérance ou de liberté si l’on attribue à la vérité, plutôt qu’une valeur instrumentale (c’est-à-dire dont on pourrait se passer), une valeur substantielle (qui appartient à la nature même de la démarche scientifique). On pourrait même craindre que l’abandon de la distinction entre justification et vérité ne conduise inéluctablement à la disparition de cette dernière. On voit mal ce que la démocratie aurait à y gagner. La vérité est bien l’ultime protection dont disposent les plus faibles contre l’arbitraire des plus forts.
1 | Latour B, « Face à la crise écologique, nous avons fait exactement ce qu’il ne faut pas faire », Libération, 13 mai 2020.Sur propos.orientes.free.fr
2 | Latour B, La Vie de laboratoire, La découverte, 1979.
3 | Boudon R, L’Art de se persuader, Fayard, 1990.
4 | Foucault M, Dits et écrits, Gallimard, 2001.
5 | Bouveresse J, « L’objectivité, la connaissance et le pouvoir », in L’Infréquentable Michel Foucault, EPEL, 2001.
6 | Jacob P, « La philosophie, le journalisme, Sokal et Bricmont », Union rationaliste, 1er mars 1999. Sur union-rationaliste.org
7 | Engel P, Rorty R, À quoi bon la vérité ?, Grasset, 2006.
8 | Boghossian P, La Peur du savoir : sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, Agone, 2009.
1 Un « régime de vérité » est constitué par un système épistémique (les règles de justification des énoncés) et par les dispositifs de pouvoir dans lesquels il s’inscrit.
Thème : Rationalisme
Mots-clés : Sociologie
Publié dans le n° 344 de la revue
Partager cet article
L' auteur

Alain Policar
Chercheur associé au Cevipof, le Centre de recherches politiques de Sciences Po.
Plus d'informationsRationalisme

Une responsabilité morale du scientifique ?
Le 7 mars 2024
Apolitique ?
Le 18 octobre 2023













![[Quimper - Jeudi 8 juin 2023] Comment le citoyen peut-il se forger son opinion sur des sujets complexes ?](local/cache-gd2/f4/9ee76130abb54d16cc2bf0302a1e9d.png?1685597742)
![[*Reporté* Saint-Étienne – mardi 28 mars] Science et pseudo-sciences](local/cache-gd2/7c/4a72bb966182f830bae8d21777041d.jpg?1681568330)











