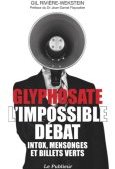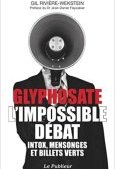Le bilan économique des pesticides : positif ou négatif ?
Publié en ligne le 21 mai 2016 - Agriculture -Dans son dossier sur les pesticides, la revue Science et pseudo-sciences (SPS) a tenté de faire un inventaire impartial des connaissances scientifiques sur leurs effets favorables et défavorables, et a appelé à une analyse coûts/bénéfices (ACB) de ces produits, afin de mieux éclairer les citoyens et décideurs politiques (SPS numéros 315 et 316). L’actualité nous a finalement rattrapés, puisqu’une étude de ce type est parue, quelques semaines avant la parution de la 2ème partie du dossier (SPS n° 316).
Réalisée par deux chercheurs de l’INRA, Denis Bourguet et Thomas Guillemaud (B&G dans la suite de ce texte), cette analyse 1 du bilan économique global des pesticides a été largement citée et commentée dans la presse. En effet, contrairement à la majorité des études précédentes, pour la plupart assez anciennes, les deux auteurs français arrivent à la conclusion que le bilan économique des pesticides est dans l’ensemble très négatif, si tous les coûts cachés de ces produits sont pris en compte. Leur démonstration s’appuie sur l’exemple des États-Unis : les auteurs ont actualisé les analyses coûts/bénéfices réalisées par le chercheur américain David Pimentel pendant les années 90, en y ajoutant des coûts cachés qu’ils ont identifiés et en révisant le calcul de certains coûts déjà pris en compte à l’époque. Avec cette méthode, le bilan final est inversé : David Pimentel trouvait, en 1992, un rapport bénéfices/coûts largement positif : 27 milliards de bénéfices par an pour 17 milliards de coûts. À l’inverse, B&G obtiennent un bilan largement négatif, avec 38 milliards de coûts, ce qui les amène à un ratio bénéfice/coût de 0,7. S’ils étaient confirmés, ces chiffres remettraient radicalement en cause l’argument central en faveur de l’usage des pesticides, c’est-à-dire leur efficacité économique. Prenons donc le temps d’analyser plus en détail ce qui a conduit à ces divergences.
Une note de l’Académie d’Agriculture 2 a déjà fait une étude critique de cette publication, en rappelant les éléments que devrait contenir une analyse coûts-bénéfices de ce type, et qui ont été oubliés ou traités superficiellement dans la publication de Bouguet et Guillemaud. Dans la présente revue, nous allons rentrer un peu plus dans les détails du raisonnement suivi par les auteurs. Nous allons ainsi vérifier quels sont les élements de leurs calculs qui les ont conduits à un bilan économique négatif, et vérfier la robustesse de ce calcul qui contredit les publications initiales sur lesquelles ils s’appuyaient.
Des coûts cachés parfois surprenants…
Comment ces deux auteurs arrivent-ils à des résultats opposés à ceux de David Pimentel, en partant de ses propres chiffres ? La lecture du résumé laisse penser que c’est en raison de coûts cachés qui auraient été négligés. Cependant, l’examen du récapitulatif produit (tableau 2.14) montre que ces coûts cachés non pris en compte par David Pimentel n’ont en définitive qu’un impact mineur sur le bilan final. Les différences viennent essentiellement de la façon dont B&G ont réévalué des coûts déjà calculés par le chercheur américain.
Notons d’abord une bizarrerie : pourquoi B&G ont-ils choisi de repartir d’une étude de David Pimentel datant de 1992, alors que celui-ci a lui-même actualisé ses propres travaux à plusieurs reprises, dans des publications s’étalant de 1997 à 2014 (tableau 2.15) ? Dans ses études plus récentes, David Pimentel prenait en compte les mêmes postes de coûts que dans celle de 1992 (tableau 2.13), et on peut supposer qu’il avait entretemps amélioré les méthodes de calcul. Au fil des actualisations de l’analyse, le ratio bénéfices/coûts est passé de 1,59 en 1992 à 2,30. Si B&G avaient appliqué la même correction de coûts (+ 21 milliards de $) à cette dernière analyse, leur résultat serait resté positif (bien que faiblement) et n’aurait sans doute pas eu le même impact médiatique. Pourquoi donc revenir à des chiffres aussi anciens que 1992 ? Les auteurs ont sans doute des raisons pour cela, mais aucune explication n’est fournie.
Venons-en aux coûts cachés ajoutés par B&G. Certains sont logiques, et il était effectivement nécessaire de les ajouter pour une analyse exhaustive : par exemple la prise en compte du coût public des procédures d’homologation des pesticides, ou de contrôle des résidus dans les aliments. Toutefois, ces coûts cachés totalisent 1,8 milliards de $/an dans l’estimation de B&G, ce qui est insuffisant pour changer radicalement le bilan.
Par contre, l’introduction d’autres coûts cachés demanderait à être mieux étayée. Ainsi, les auteurs mettent au débit des pesticides 2,4 milliards de $ de pertes de rendement dues aux pathogènes résistants aux pesticides… c’est-à-dire, une fraction des pertes de rendement qui se produiraient en absence de pesticides ! Cette déduction serait légitime, si les bénéfices directs des pesticides avaient été calculés très finement à partir de l’étude de parcelles exemptes de problèmes de résistance. S’il s’agit de simples estimations basées sur les différences moyennes de rendement entre agricultures conventionnelle et biologique, les pertes de rendement locales dues aux résistances sont déjà intégrées dans le rendement moyen de l’agriculture conventionnelle, il n’y a pas lieu de les compter une 2e fois. Comme les auteurs n’expliquent pas clairement la façon dont les bénéfices sont calculés, il est difficile de savoir si ce coût supplémentaire de 2,4 milliards de $ est justifié.
Des coûts cachés sous-estimés, vraiment ?
C’est un leitmotiv tout au long de la publication : les coûts réels des pesticides seraient sous-estimés. Reprenons l’exemple du deuxième plus gros poste de coûts cachés, avec près de 6 milliards de dollars : celui des pertes dues aux décès d’oiseaux sauvages empoisonnés.
D’après la note (e) du tableau 2.14, l’estimation du nombre d’oiseaux tués par les insecticides aux États-Unis provient d’une publication de 2005 3. En fait, cette étude traite a posteriori de l’impact du carbofuran, un insecticide autrefois utilisé sous forme de granulés en traitement du sol. Les comptages d’oiseaux morts cités dans cette étude datent des années 70 à 80, et P. Mineau, l’auteur de cette publication, n’oublie pas de mentionner (contrairement à B&G), que ce problème ne concernait déjà plus les États-Unis, où l’utilisation du carbofuran a été très sévèrement limitée à partir de 1994 4. Or, comme nous l’avons déjà souligné, l’analyse coûts bénéfices de B&G correspond à des chiffres de 1992. Il est donc légitime d’utiliser les résultats de P. Mineau, mais pour éviter tout amalgame, B&G auraient dû préciser explicitement que la situation a évolué depuis.
Mais même par rapport à la situation de 1992, les chiffres présentés paraissent très pessimistes. Reprenons le calcul : P. Mineau, l’auteur de l’étude de 2005, arrivait à une fourchette assez large : 17 à 91 millions d’oiseaux morts par an. Cette estimation était obtenue en extrapolant des comptages d’oiseaux morts dans les champs de maïs. Parmi ces comptages, l’alouette hausse-col (Horned Lark, Eremophila alpestris) représentait la moitié à deux tiers des victimes selon les États (tableau 3). L’estimation de P. Mineau revient donc à considérer que les pesticides auraient tué de 8,5 à 60 millions d’alouettes hausse-col par an aux États-Unis. Une estimation assez audacieuse, sachant que :
- la population américaine (États-Unis) de cette espèce est estimée à 55 millions 5 ;
- d’après le Cornell Lab of Ornithology, elle a décliné en moyenne de 2,2 % entre 1966 et 2010, essentiellement à cause de la diminution des surfaces agricoles qui lui étaient favorables 6.
On ne peut donc pas accuser l’auteur d’avoir sous-estimé l’effet des pesticides sur ce bel oiseau (que l’UICN classe dans les espèces non menacées) 7. Malgré cela, B&G ont préféré prendre un facteur de sécurité non négligeable : les 17 à 91 millions d’oiseaux tués, estimés par P. Mineau, sont arrondis hardiment à 100 millions. Chiffre qu’ils multiplient par 30 $ (valeur estimée par D. Pimentel), ce qui devrait faire 3 milliards de $, alors que le chiffre affiché est de… 5,903 milliards de $ (tableau 2.14, note e). Il n’y a aucune explication sur l’origine des 2,903 milliards supplémentaires.
Si le bio coûte cher : c’est la faute aux pesticides !
Le dernier coût caché calculé par B&G est carrément surréaliste : ils comptabilisent 3 milliards de $ de surcoût engendré par l’achat de produits alimentaires bio, au prétexte que le choix de consommer bio serait dû en partie (dans 50 % des cas d’après eux) à la peur des pesticides ! B&G ont apparemment oublié que, si les pesticides n’existaient pas, ce seraient 100 % de la population qui seraient obligés de manger bio à 100 %... et donc au prix du bio 8. Voire encore plus cher que le prix actuel du bio, car les pertes drastiques de rendement et de productivité qu’entraînerait l’absence de pesticides provoqueraient probablement une flambée des prix, encore plus importante que le différentiel actuel entre produits bio et produits de l’agriculture conventionnelle.
Le problème des coûts sanitaires
Cependant, cette curieuse analyse sur le bio ne pèse finalement pas très lourd dans le ratio final bénéfices/coûts. Ce qui fait basculer le bilan dans le rouge est un coût indirect, que David Pimentel avait pourtant pris en compte, mais que B&G ont réévalué de façon radicale : le coût des cancers dus aux intoxications chroniques par les pesticides. B&G ont repris l’estimation de David Pimentel sur le nombre de cancers provoqués par les pesticides : 10 000 cas par an aux États-Unis. À partir de ce chiffre, David Pimentel avait comptabilisé un coût de traitement de 707 millions de $ en 1992, que B&G ont actualisé à 1,2 milliard. Mais surtout, ils ont estimé que ces cas de cancers avaient entraîné 2 000 décès, comptés chacun pour 9 millions de $, soit 18 milliards de $ : la moitié du coût total estimé des pesticides. David Pimentel avait aussi comptabilisé des décès en 1997, mais seulement ceux dus aux intoxications aiguës, pas ceux dus au cancer. Il arrivait ainsi à 45 cas par an (chiffre conservé par B&G), comptabilisés pour 3,7 millions de $ chacun (au lieu donc des 9 millions de $ retenus par B&G).
Quitte à actualiser le coût unitaire des décès retenus, n’est-il pas aussi nécessaire de réviser leur nombre ? Dans la note (d) de leur tableau 2.14, B&G disent que l’estimation des 10 000 cas de cancers par an provient d’un article de David Pimentel de 2005. Par ailleurs, leur estimation selon laquelle 20 % des cas déclarés conduiraient à un décès provient d’une étude récente, mais sur la population générale et non spécialement le milieu agricole 9.
Si on revient sur l’article de David Pimentel de 2005, d’où provient l’estimation de 10 000 cancers annuels induit par les pesticides, on constate deux choses :
- L’argumentation de ce chiffrage repose essentiellement sur les observations chez les agriculteurs utilisateurs de pesticides. Malheureusement, David Pimentel ne distingue pas, dans son chiffrage total, les cas de cancer chez ces utilisateurs professionnels et ceux qui surviendraient éventuellement dans la population générale, suite aux expositions non professionnelles aux pesticides.
- Il ne s’agit pas d’une estimation nouvelle, mais simplement de la reprise d’une estimation de 1992.
Or, à cette époque, l’auteur ne disposait pas de résultats d’études épidémiologiques permettant d’étayer sérieusement ce chiffre. Depuis, les connaissances scientifiques ont beaucoup progressé, notamment grâce aux études sur la cohorte Agricultural Health Study (AHS), qui a montré que les agriculteurs ont une prévalence globale des cancers significativement plus faible que la population générale 10. Il y a toutefois quelques types de cancers qui sont surreprésentés (en terme d’incidence ou de prévalence, c’est-à-dire de nombre de cas observés) chez les applicateurs de pesticides, comme le cancer de la prostate 11. Même si le lien de causalité entre ces cancers et les pesticides n’est pas encore établi de façon très claire, il serait donc compréhensible, par précaution, de comptabiliser les surmortalités de ces cancers au débit des pesticides. Toutefois, les analyses sur la mortalité donnent un résultat un peu inattendu : même pour les cancers surreprésentés (en incidence ou en prévalence) chez les applicateurs de pesticides, aucune surmortalité significative n’a été observée 12 !
Ce résultat apparemment paradoxal est pourtant solide statistiquement. Il a été conforté par la deuxième grande cohorte mondiale de suivi de la santé des agriculteurs, la cohorte française Agrican, qui donne les mêmes résultats : la mortalité des agriculteurs y est pour l’instant moins élevée que dans la population générale pour tous les cancers, y compris pour les quelques localisations surreprésentées dans la cohorte (myélome multiple et plasmocytome pour les hommes, mélanome de la peau pour les femmes) 13. Dans le cas d’Agrican, les résultats sont moins robustes, car la cohorte est plus récente (le recrutement a commencé en 2005) et les chiffres de mortalité ne sont donc que provisoires, mais il est rassurant de noter qu’ils sont pour l’instant cohérents avec ceux de l’AHS (débutée en 1993).
À notre connaissance, l’explication de cette discordance entre prévalence et mortalité n’a pas fait l’objet d’étude spécifique. En attendant que cette question soit éclaircie par les épidémiologistes 14 dans les deux grandes cohortes prospectives mondiales sur le sujet, il n’y a donc actuellement aucun résultat significatif indiquant sans équivoque un excès de mortalité par cancer chez les agriculteurs utilisateurs de pesticides, pour quelque localisation que ce soit. Par conséquent, il est évident que le taux de mortalité de 20 % utilisé par B&G est inapproprié pour les cancers excédentaires observés chez les agriculteurs. Les 2000 décès supplémentaires calculés par B&G devraient donc être revus drastiquement à la baisse. Or nous avons vu que ce sont eux qui faisaient basculer complètement leur analyse coût/bénéfice.
Et les bénéfices indirects des pesticides ?
À l’inverse, l’évaluation des bénéfices des pesticides n’a pas fait l’objet d’une telle réévaluation. Les auteurs se sont contentés de reprendre telles quelles les estimations de David Pimentel (en reprenant la plus basse, celle de 1992, alors que la même méthode conduisait à des bénéfices presque doublés dans ses derniers travaux : 48 milliards de $ au lieu de 27 15). Il s’agit donc toujours de bénéfices directs, c’est-à-dire de la valeur des gains de production permis par les pesticides.
Il y aurait pourtant des bénéfices plus indirects à prendre en compte :
- Sur le plan économique : les bénéfices directs calculés sont des bénéfices micro-économiques, au niveau des exploitations agricoles. À l’échelle macro-économique, les gains de rendement dus aux pesticides ont permis de modérer les tensions sur les cours des matières premières agricoles. Sur ce marché devenu hautement spéculatif, une interdiction des pesticides aurait un impact majeur sur la production, et donc sur les prix pour les consommateurs.
- Sur le plan sanitaire : les études nutritionnelles ont établi que la proportion de fruits et légumes dans l’alimentation a un impact majeur sur la santé. Or cette part des fruits et légumes dans le régime alimentaire est elle-même fortement influencée par leur prix. Une étude de l’American Heart Association 16 estime qu’une baisse de 30 % du prix des fruits et légumes aux États-Unis permettrait d’éviter environ 191 000 à 210 000 morts sur 15 ans, soit 13 000 décès par an environ. Dans l’autre sens (c’est-à-dire l’impact non plus d’une baisse des prix mais d’une hausse), un article publié dans le Lancet 17 estime que le changement climatique d’ici 2050 pourrait provoquer une baisse de production des fruits et légumes de 4 % au niveau mondial, ce qui produirait un excédent de mortalité de 529 000 décès par an, dont 70 000 pour les pays développés. On notera que, dans ces deux exemples, les écarts de prix ou de production envisagés sont nettement inférieurs à ceux des écarts entre agriculture bio et conventionnelle. Si on appliquait les mêmes méthodes au calcul des bénéfices indirects des pesticides, on arriverait donc à des vies sauvées par dizaines de milliers chaque année, à comparer aux très discutables 2 000 décès de B&G. Sans compter leur bénéfice sanitaire direct sur la réduction des mycotoxines et autres contaminations biologiques dans les aliments, difficiles à chiffrer il est vrai.
- Sur le plan environnemental : personne ne conteste sérieusement que les pesticides permettent d’augmenter les rendements, et donc de réduire la surface agricole nécessaire pour nous nourrir. Quel est l’impact de ce bénéfice indirect sur la biodiversité ? Pas un mot là-dessus dans l’étude de B&G. Dans son rapport Living Planet de 2014, le Worlwide Wildlife Fund estime que, parmi les espèces animales en danger d’extinction, 4 % le sont à cause de pollutions (dont les pesticides, mais pas uniquement), alors que 45 % sont victimes de la dégradation (31,4 %) ou de la destruction (13,4 %) de leur habitat 18. Or le défrichage pour l’agriculture est une des causes majeures de ces destructions d’habitat. Si les pesticides n’existaient pas, il faudrait donc s’interroger sur l’augmentation de la surface agricole que cela induirait, et l’impact que cette augmentation aurait sur la destruction d’espaces naturels et sur la biodiversité.
Une analyse coût-bénéfices qui reste à faire
Cet inventaire rapide des différentes externalités, positives ou négatives, des pesticides confirme la nécessité de réaliser une analyse coûts/bénéfices globale à leur sujet, mais aussi toute la difficulté de cet exercice.
L’article de B&G ne fait qu’effleurer ce sujet, et de façon très partiale :
- Les trois coûts indirects les plus importants calculés par ces auteurs sont soit absurdes (prise en compte du surcoût de l’alimentation bio), soit obsolètes (impact sur la faune sauvage estimé à partir du cas d’un insecticide interdit depuis longtemps, et à l’impact sans doute surestimé ; coûts sanitaires calculés à partir d’hypothèses sur la mortalité réfutées depuis par les études épidémiologiques).
- Le ratio bénéfices/coûts calculé au final, qui a justifié son retentissement médiatique, est en fait un ratio bénéfices directs/coûts totaux ». Même si on acceptait les chiffrages très discutables des auteurs, il ne serait pas étonnant que cet étrange bilan soit déséquilibré. Il faudrait à l’évidence ajouter aussi les bénéfices indirects ou cachés des pesticides : effet macroéconomique sur le coût des aliments (qui a lui-même des conséquences sanitaires favorables), effets positifs sur la biodiversité par effet de « land sparing », c’est-à-dire réduction de la surface agricole nécessaire. Le calcul de ces bénéfices indirects reste pour sa plus grande part à réaliser, et nécessiterait des collaborations transdisciplinaires (avec des économistes spécialistes des matières premières, des épidémiologistes, des agro-écologistes), ce qui n’a pas été le cas dans cette étude.
En plus de ce déséquilibre dans les hypothèses de départ, on constate que, finalement, le bilan économique négatif obtenu repose uniquement sur deux postes de coûts cachés : la prise en compte des décès de victimes humaines ou animales des pesticides.
Cela pose l’éternel problème des analyses couts-bénéfices, quand elles doivent prendre en compte des décès : la difficulté d’attribuer une valeur à une vie humaine ou animale. Cette question dépasse largement le cadre de la réflexion scientifique. Plutôt que d’outrepasser leurs compétences en attribuant aux décès une valeur non strictement économique, les experts chargés de ces analyses feraient mieux de décomposer leurs bilans en 3 parties strictement scientifiques et objectives :
- coût strictement économique (sans évaluation des décès) ;
- bilan sanitaire net en termes de vies perdues ou gagnées ;
- bilan environnemental net.
et de laisser au législateur (ou aux citoyens, par voie de référendum) le soin de trancher sur la façon d’arbitrer entre les différents éléments de ce bilan. En attribuant aux décès une valeur monétaire, quelle que soit la justification de leur calcul, les chercheurs pratiquent un mélange des genres entre considérations factuelles et éthiques, qui obscurcit le débat et nuit à la transparence normale des raisonnements scientifiques.
De plus, ce débat a de grandes chances d’être sans objet au sujet des pesticides. La question du coût d’une vie humaine ou animale ne se pose en effet que si le bilan sanitaire ou environnemental est globalement négatif. Or nous avons vu que, si l’on intègre leurs bénéfices indirects (notamment la baisse du prix des fruits et légumes), le bilan sanitaire des pesticides est probablement largement positif. De même, pour la biodiversité, même si le débat est encore bien plus complexe (voir notre article « Les pesticides nuisent-ils à la biodiversité ? » 19), il est probable que là aussi le bilan est globalement positif, même si bien sûr la situation n’est pas la même pour les espèces habituellement associées aux cultures, et celles qui vivent dans les milieux naturels.
En conclusion, cette étude a le mérite de remettre sous les feux de l’actualité l’analyse coût/bénéfice des pesticides, un sujet essentiel, et pourtant délaissé par l’INRA, et de faire une synthèse bibliographique utile sur les travaux déjà existants. Par contre, l’analyse réalisée par les auteurs est inacceptable en l’état, en raison de son asymétrie (pour ne pas dire sa partialité), et de la superficialité de l’actualisation proposée.
2 Boussard JM. 2016. A propos des coûts externes des pesticides, N3AF, 1, 1-7. Disponible sur academie-agriculture.fr
3 Mineau P (2005) “Direct losses of birds to pesticides – beginnings of a quantification”. In : Ralph CJ, Rich TD (eds) Bird conservation implementation and integration in the Americas : proceedings of the third international partners in flight conference 2002, U.S.D.A. Forest Service, GTRPSW-191, Albany ; Vol 2, pp 1065–1070.
5 https://pif.birdconservancy.org/wp-content/uploads/2021/03/Handbook-to-the-PIF-Population-Estimates-Database-Version-2.0.pdf
8 Notons que le bio utilise aussi des pesticides, mais les auteurs, dans leur analyse, ne visent sans doute que les pesticides de synthèse non utilisables en bio.
9 Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A (2014) Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 64:9–29
11 DOI:10.1097%2FJOM.0b013e3181f72b7c, tableau 2
12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3025641/ , tableau 4. À propos de cette étude, notons que, contrairement à une interprétation erronée favorisée par l’ambiguïté du texte de l’article, c’est bien l’indicateur montré dans ce tableau 4 (le Standardized Mortality Ratio, SMR) qui permet de vérifier s’il y a surmortalité ou non par rapport à la population générale. Le Relative Standardized Mortality Ratio (rSMR), présenté dans le tableau 5, permet simplement de vérifier s’il y a des différences significatives dans l’importance relative des causes de mortalité, entre les applicateurs de pesticides et la population générale. Par exemple, le lymphome non-hodgkinien (LNH) a un SMR non différent de 1, mais un rSMR significativement supérieur à 1 : cela signifie que, chez les applicateurs de pesticides, il n’y a pas d’excès de LNH. Par contre, pour eux, la probabilité de mourir d’un LNH est plus élevée que pour la population générale, tout simplement parce que leur mortalité pour cette maladie est normale, alors que celle de la plupart des autres cancers est significativement inférieure à la normale. Le rSMR redresse aussi les résultats, pour aligner la mortalité globale de la population étudiée sur la population de référence. Ce redressement serait justifié si la différence de mortalité globale entre les deux populations était due à un biais d’échantillonage. Mais il n’y a aucune raison de penser que ce soit le cas dans une cohorte prospective aussi grande que l’AHS.
14 Il est d’ailleurs très regrettable que l’expertise collective de l’INSERM en 2013 n’ait pas soulevé ce sujet, ni formulé la moindre recommandation pour le traiter à l’avenir.
15 On peut aussi noter que dans la note de l’Académie d’Agriculture déjà citée, J-M Boussard estime ce bénéfice direct entre 60 et 90 milliards de $.
16 http://newsroom.heart.org/news/policies-to-lower-prices-on-fruits-and-vegetables-may-help-save-thousands-of-lives?preview=0641
18 https://livingplanet.panda.org , page 22.
Partager cet article
L' auteur

Philippe Stoop
Philippe Stoop est Docteur-Ingénieur en agronomie, est le directeur Recherche et Innovation de la société iTK, (…)
Plus d'informationsAgriculture
Thèmes connexes : Agriculture et alimentation bio, Alimentation
Le glyphosate est-il cancérogène ?
Le 16 février 2018
L’agriculture du Lauragais au milieu du XIXe siècle
Le 12 janvier 2022Communiqués de l'AFIS

« Extinction Rebellion » tente d’interdire une conférence de l’Afis
Le 3 février 2023












![[Lyon - Mercredi 28 février 2024 à 20H30] Soirée Ciné-Café : Au pays de l'abeille noire](local/cache-gd2/41/504edd6b853ac09a87f1c6b0378d64.png?1707108191)
![[Lyon - samedi 29 avril 2023] Pollution des Antilles au Chlordécone : Origines et conséquences](local/cache-gd2/8b/1668648b1d4cf123c90d8e3194fba0.jpg?1681553459)
![[Paris - jeudi 2 février 2023] Glyphosate - Santé, Environnement, Agronomie : Comment s'y retrouver ?](local/cache-gd2/b0/8778a383cc5b44b4c0c95cb1ccd51f.jpg?1681577057)