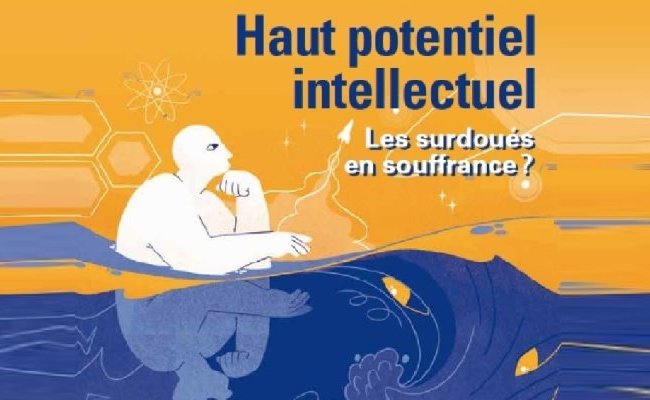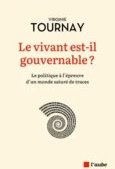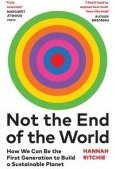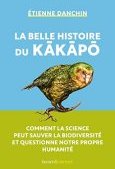La survie des médiocres
Publié en ligne le 25 juin 2024Daniel S. Milo
Gallimard, 2024, 416 pages, 27 €
Ce livre a connu un grand écho médiatique. Guillaume Lecointre procède ici à une analyse de l’ouvrage et décrit une critique de la théorie de l’évolution qui « est en réalité celle de clichés que l’on trouve encore dans les media ».

Daniel S. Milo publie cet essai du point de vue du philosophe, mais tente néanmoins de fonder une nouvelle « théorie » scientifique, celle dite du « good enough » [« suffisant »]. Un premier problème consiste à identifier de quel type de production intellectuelle il s’agit. La déontologie du métier scientifique impose que quiconque veut fonder un champ scientifique nouveau ou seulement amender celui qui est en cours doit publier des preuves dans des revues à comité de lecture. De son propre aveu, l’auteur de cet essai n’a pas le fondement expérimental nécessaire à l’appui de ses thèses. Mais quelles sont-elles ?
Prémisses et conséquences
Première prémisse, D. Milo part du principe que la théorie de l’évolution par voie de sélection naturelle, autant celle de Darwin que celle de ses continuateurs d’aujourd’hui, prévoirait d’éradiquer le superflu, le « mal-fichu », les « médiocres ». Comme il constate – à raison – que le vivant est plein de « superflu », il pense devoir changer de théorie. Il n’y a pas que le superflu, dont D. Milo pense qu’il ne serait pas pris en charge par la théorie actuelle, il y a aussi la profusion, le foisonnement, le « trop ». Le vivant est rempli de « tropéité ». Trop d’ADN poubelle, trop d’ADN inutile dans la polyploïdie, trop de néphrons dans le rein, trop de spermatozoïdes, trop loin de la moyenne de son espèce ce poisson-lune de 2 744 kilos, trop longues les jambes de la girafe, trop grandes les excroissances du corps des membracides, un groupe d’insectes dont « les excroissances dorsales […] font trois, quatre, cinq fois la taille de leur corps » 2 !
« Les entreprises aspirent à produire plus avec moins de travailleurs, moins de matériaux, moins de temps, sinon elles risquent la faillite. » Au contraire, « les animaux, les plantes et les microbes se débrouillent à faire la même chose avec toujours plus de moyens. [...] Contrairement à une idée reçue, le gaspillage et la prodigalité sont rarement punis dans la nature. » La sélection naturelle, telle qu’il affirme qu’elle est pensée par Darwin et par les évolutionnistes d’aujourd’hui, échouerait à en rendre compte parce qu’elle a été inspirée de la domestication où les organismes sont optimisés par l’humain et influencée par les organisations capitalistes du travail. Cela nous amène au point suivant.
Seconde prémisse, Darwin avait fondé la sélection naturelle par analogie avec la sélection artificielle. Dans le cas de celle-ci, c’est l’humain qui sélectionne le vivant en vue de l’utilité d’un trait. Il en émerge donc de l’utile, comme le rendement laitier du cheptel bovin ou les qualités esthétiques de certaines races de pigeons chères à Charles Darwin. Selon l’auteur de La Survie des médiocres, l’analogie aurait empêché de penser l’inutile dans le cadre de la sélection naturelle : elle n’aboutirait qu’à des perfections fonctionnelles, des optimisations. Les scientifiques de l’évolution ne penseraient l’issue d’un lignage biologique que dans l’excellence, l’innovation, l’optimisation.
Troisième prémisse, D. Milo présente la pensée des évolutionnistes modernes comme pan-sélectionniste, c’est-à-dire que la sélection naturelle serait vue par eux comme omnipotente et mobilisée comme explication par défaut dans tous les cas étudiés : « tout est sélectionné jusqu’à preuve du contraire » ; « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». En somme, les évolutionnistes d’aujourd’hui seraient panglossiens 3.
Enfin, quatrième prémisse, la sélection naturelle ne serait que lutte compétitrice [1].
D. Milo s’inscrit donc en faux contre ces quatre prémisses affirmées. À la première prétendue représentation, il oppose le superflu. Devant le superflu de la taille des membres de la girafe, il va même jusqu’à écrire : « Si la théorie de l’évolution ne reposait que sur [la girafe], on serait obligé de l’abandonner. » À la seconde prétendue représentation, il oppose la survie non pas du « fittest » (le mieux adapté), mais du « luckiest » (le plus chanceux) : la majorité des organismes ne devraient leur survie qu’au hasard et non en raison de leurs capacités (de leur adaptation optimale au milieu). À la troisième prétendue représentation, il oppose l’argument selon lequel la sélection naturelle ne serait réellement mobilisable et explicative que dans 10 % des phénomènes évolutionnaires. Sa théorie du « good enough » expliquerait les 90 % restants : « La sélection naturelle façonne les fittest ; le good enough rend compte des médiocres. » Elle serait une théorie de l’« indifférence naturelle », ou de la « tolérance naturelle ».
Il affirme que la haute fréquence des excès quantitatifs associée aux larges gammes de variations quantitatives (ce qu’il appelle le « polyquantisme ») ruine l’équation « évolution = sélection naturelle ». Il est fasciné par l’immensité des fourchettes de tailles : les palourdes géantes peuvent ne mesurer que quelques centimètres ou bien près de cent, avec une distribution assez uniforme sur toute la gamme. Les gammes de tolérance sont fortement biaisées vers l’excès. Si elle n’était pas tolérante aux médiocres, la sélection ne devrait pas laisser passer ces trop grandes marges de variations. Il propose alors une théorie des origines de l’excès, que nous n’avons pas la place de développer ici, mais qui selon moi s’intègrerait parfaitement dans la théorie actuelle sans qu’il y ait besoin de la présenter comme une alternative.
Des fondements biaisés
Sa présentation de la pensée de Darwin, et surtout de celle des évolutionnistes d’aujourd’hui, est fondée sur des oppositions forcées et un faux procès. Ainsi, elle tient plus du sophisme de l’homme de paille que de l’analyse.
Sur le premier prétendu constat de D. Milo, il convient de faire remarquer que nous n’en sommes plus à l’époque de Darwin, que le consensus scientifique sur l’évolution biologique a évolué et que l’inutile est compatible avec la théorie moderne de l’évolution, laquelle ne fait nullement l’apologie de la performance. La plupart des organes inutiles sont le fruit d’une histoire. Si nous possédons des muscles inutiles, c’est que certains de nos ancêtres animaux les utilisaient, mais plus nous : c’est ainsi que nous avons trois muscles du pavillon de l’oreille, pourtant nous ne remuons plus les oreilles. Des muscles thoraciques transverses vestigiaux ne servent plus à ouvrir la cage thoracique (c’est le diaphragme qui fait le travail), etc. Ces structures persistent malgré leur obsolescence depuis plusieurs dizaines de millions d’années. Preuve absolue de leur inutilité, beaucoup de ces structures sont même inconstantes parmi nous : certaines personnes ont des côtes surnuméraires sur la septième vertèbre cervicale ou encore sur la première vertèbre lombaire, d’autres ont un muscle surnuméraire sur le dessus de la main, le muscle manieux. Ceci est le fruit d’héritages historiques, parfaitement intégrés à la théorie moderne de l’évolution. D’autres inutilités proviennent de contraintes de construction embryonnaire : le téton n’est pas utile à l’organisme mâle.
Quant à la profusion, elle est parfaitement prise en charge par la théorie moderne de l’évolution. C’est précisément parce que les populations d’êtres vivants saturent les milieux, c’est parce qu’ils « en font trop », qu’une partie d’entre eux se maintiennent dans un milieu donné, que le lignage se perpétue. L’excès est la règle et l’économie de moyens l’exception (pourtant, D. Milo dit à peu près la même chose : « Le n’importe-quoi est la norme dans le génome comme dans la vie, et le sens y est l’exception »). Darwin l’avait déjà intégré dans son raisonnement (voir par exemple [2] p. 66). On ne peut pas dire que la « tropéité » ait été négligée. D’ailleurs, ce motif majeur de sa propre théorie de remplacement reste inopérant sur le plan épistémologique : D. Milo ne répond pas à sa question « how much is too much ? » [« trop, c’est combien ? »]. Le « trop » n’est pas le fruit de la sélection naturelle, ni même l’aboutissement d’un quelconque autre processus, mais la condition initiale à partir de laquelle elle est rendue possible. D’ailleurs, l’auteur le reconnaît : « Ne dites pas “la sélection naturelle favorise la variation”, dites “la sélection naturelle est le sous-produit de la variation” ». D. Milo n’est pas contre la sélection naturelle, mais il souligne que sa survenue est rare et que ses fourches caudines sont très relâchées.
Au second motif, celui des perfections, la théorie actuelle de la sélection naturelle ne conçoit ni des optimisations ni des perfections, mais des compromis (trade-offs). Compromis entre devoir séduire le sexe opposé et devoir se cacher de ses prédateurs. Compromis entre compétition parmi les congénères et coopération. Ces compromis produisent des morts à chaque génération [3] et on est loin de l’« excellence ».
En ce qui concerne la troisième critique, le « tout sélectif » n’est plus de mise depuis la fin des années 1960 : avec le « neutralisme » de Motoo Kimura, on sut que la plupart des changements génétiques étaient sélectivement neutres. D. Milo présente l’évolution moderne comme si le diktat de l’utilité (autrement dit du fonctionnel) était le régime d’explication par défaut (ce qu’on appelle en science l’hypothèse nulle). Or ce n’est pas la pensée des biologistes d’aujourd’hui. On teste bien des effets sélectifs contre l’hypothèse nulle de neutralité. Et l’on sait que l’approche empirique du changement populationnel conclut davantage sur des constats de neutralité que sur des cas avérés de sélection. Beaucoup de traits variant sous différentes versions montrent ce qu’on appelle un polymorphisme qui se maintient à travers le temps : la fréquence des différents variants fluctue aléatoirement au cours des générations justement parce que ces traits sont neutres. Typiquement, c’est le cas des variations de la plupart de nos enzymes. Par ailleurs, D. Milo cite bien le neutralisme, mais curieusement il en fait très peu cas, et retourne sa critique contre le « tout-sélectif » à l’échelle des caractères anatomiques. Or celle-ci non plus n’est pas nouvelle. Le « tout-sélectif » à cette échelle-là avait été déjà critiqué en 1979 par Stephen Jay Gould et Richard Lewontin dans un article retentissant [4]. En somme, la théorie moderne de l’évolution sait faire la différence entre causalité et utilité. Enfin, les excès réductionnistes de la sociobiologie avaient déjà été discutés et critiqués largement entre 1975 et 1985.
Quant à la quatrième prémisse, celle de la sélection naturelle réduite à la compétition, inutile de s’étendre sur cette contre-vérité : on renverra à l’origine naturelle de la coopération, de l’entraide et du soin porté aux congénères, en somme à l’origine naturelle des sociétés animales par la voie de la sélection naturelle, précisément, pensée par Darwin lui-même dès 1871 [5,6].
La nature ne tendrait pas vers l’innovation, mais vers la conservation. La théorie de l’évolution devrait être une théorie de la stagnation. L’idée est intéressante, mais elle est présentée comme une nouveauté, alors que c’est déjà inscrit dans le sous-titre du maître livre de Charles Darwin ! En effet, Darwin fait l’effort de résoudre la question de l’origine de la ressemblance resserrée dans l’espèce, et donc de la discontinuité des ressemblances entre espèces. Il s’agit bien de l’origine des espèces par l’élucidation de l’origine de la ressemblance, question fondamentale à laquelle Darwin trouve une réponse épistémologique : face à la variation infinie des êtres causée par l’instabilité de la matière, comment peuvent-ils encore se ressembler ? La sélection naturelle élaguant les formes extrêmes, les survivants se ressemblent plus que le potentiel de variation initial n’aurait pu le laisser supposer. Sur le court terme, c’est-à-dire tant que le milieu ne change pas, la sélection naturelle est conservatrice. Le sous-titre du maître livre de Darwin est éloquent : La préservation des variants favorisés au cours de la lutte pour l’existence [7]. On parle bien de la préservation d’une moyenne, et non d’évolution ni de transformation [3,8].
Les critiques dont part D. Milo pour justifier sa vision sont non seulement des récurrences, mais sont surtout infondées compte tenu de ce qu’est la théorie évolutionnaire d’aujourd’hui. D’ailleurs, il est étrange que D. Milo ne tienne pas compte de la théorie évolutionnaire étendue [9] qui porte le focus sur l’organisme, et non plus seulement sur le gène. Plus intégrative, elle est davantage capable de révéler les compromis entre effets sélectifs.
Un amalgame des faits et des valeurs
Mais il y a plus grave. Le sous-titre du livre indique explicitement l’amalgame qui est fait : Critique du darwinisme et du capitalisme. S’il y a de bonnes raisons de critiquer le capitalisme et le culte de la performance, on n’a pas besoin de réinventer une théorie scientifique pour cela, en l’occurrence la théorie du « good enough » qui, en outre, échoue à fournir ses preuves expérimentales. Plutôt que de prendre les faits en otage, laissons la science tranquille et attaquons-nous au capitalisme dans le champ des valeurs. Le sous-titre du livre est d’autant plus désastreux que l’amalgame entre darwinisme et capitalisme est un vieux poncif dont on est certain qu’il rencontrera un écho dans toute une sphère idéologique, ce qui aura pour conséquence le refus par une partie de nos concitoyens, pour des motifs qui n’ont rien de scientifique, d’une théorie scientifique féconde qui doit encore beaucoup à Darwin sous bien des aspects. Rappelons enfin que la pensée de Darwin a été régulièrement récupérée ou combattue dans des sens politiques diamétralement opposés. Dans son livre L’Entraide, un facteur de l’évolution, Pierre Kropotkine voyait dès 1902 dans l’entraide une force majeure de l’évolution et l’origine de la coopération sociale, fondement du progrès humain.
Ce que critique D. Milo, en réalité, c’est une pédagogie désuète de la sélection naturelle et ses icônes tellement simplifiées qu’elles en sont devenues absurdes, voire de ses déformations idéologiques. Sa critique est celle de clichés que l’on trouve encore dans les media, mais qu’on ne trouve déjà plus dans les programmes d’enseignement du système secondaire français. D. Milo se trompe de cible. Et de remède. Ce n’est pas une théorie scientifique alternative qu’il faut construire, mais une pédagogie fine et audacieuse de l’évolution.
1 | « Le darwinisme, matrice idéologique du capitalisme et de ses excès ? », Émission « France Culture va plus loin », France Culture, 15 février 2024.
[2 | Lecointre G et Tort P, Le Monde de Darwin, La Martinière – La Cité des Sciences, 2015.
[3 | Lecointre G (Éd.), Guide critique de l’évolution [2e édition], Belin Éducation, 2021 (voir recension sur afis.org).
[4 | Gould SJ, Lewontin R, “The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm : A Critique of the Adaptationist Programme”, Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 1979, 205:1161.
[5 | Détroit F, « Bipédie, gros cerveau, grand-mère et forte cohésion sociale : des spécificités humaines ? », Science et pseudo-sciences n° 335, janvier 2021.
[6 | Darwin Ch, The descent of Man, and selection in relation to sex. Trad. fr. : La Filiation de l’Homme et la sélection liée au sexe, 1871, éditions Honoré Champion, 2013.
[7 | Darwin Ch, L’Origine des espèces, 1859 (traduction française de la 6e édition anglaise par A. Berra, coordonnée par M. Prum sous la direction de P. Tort, 2009), éditions Honoré Champion.
[8 | Lecointre G, Descendons-nous (vraiment) de Darwin ?, Le Pommier, 2015.
[9 | Laland KN et al, “The extended evolutionary synthesis : its structure, assumptions and predictions”, Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences, 2015, 282:20151019.
Partager cet article
Auteur de la note
Environnement et biodiversité

Microplastiques : terre inconnue ?
Le 10 mai 2024
Ne pas confondre contamination et pollution
Le 25 avril 2024
Tour d’horizon des contaminants présents dans les sols agricoles
Le 22 avril 2024Communiqués de l'AFIS