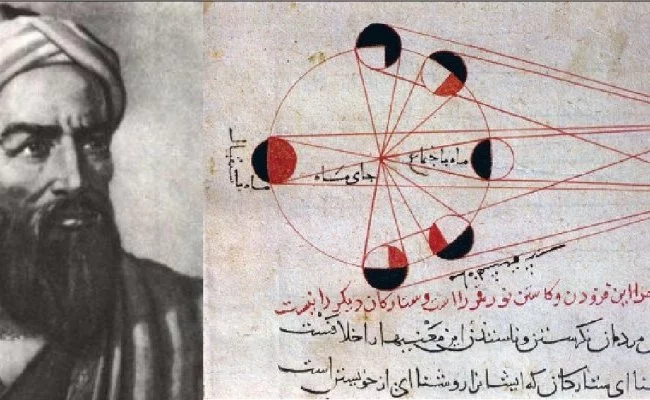Des mythologies quotidiennes aux méta-récits : Mythologies du XXIe siècle
Publié en ligne le 10 juillet 2004 - Conspirationnisme -Résumé de la conférence AFIS-IDF du 10 mai 2001
Des « mythes » et des méta-récits, nous en constatons la présence. Nous en constatons aussi le renouvellement, à l’aube du XXIe siècle. À des titres divers, ils soutiennent la vie quotidienne (objets, références, mots convenus) ou donnent de l’ampleur à la vie politique (nation, progrès). Peut-on les répertorier ? Les interpréter ? Les combattre ? En tout cas, il faut montrer que le recours aux « mythes » - et nous prenons le terme en un sens particulier - n’est pas le fait d’une faiblesse intellectuelle, que l’on pourrait éradiquer par un apprentissage ou par la substitution de la vérité scientifique. Certes, les « mythes » calment les appréhensions, donnent des « explications » qui ramènent à la tranquillité. Mais, ils remplissent aussi d’autres fonctions. Nous tenterons de les mettre au jour, en nous référant au numéro 136 de la revue Raison Présente (« Mythologies du XXIe siècle » 1) que nous avons coordonné.
– Une problématique du « mythe »
– Les usages du terme « mythe »
Introduction
Même si on se contente d’un bref repérage de quelques « mythes » contemporains, on tombe vite sur cette idée : les « mythes » ont une efficacité sociale. Ils fabriquent de « l’évidence ». Il suffit de penser à quelques rumeurs récentes pour comprendre que le « mythe » intervient là où il faut construire une telle « évidence » rassurante, afin de permettre notamment de continuer à vivre sans trop de dommages. A cet égard, le « mythe » contribue moins à définir un contenu particulier, qu’il ne manifeste un type de rapport entretenu avec le monde.
De telles références constituent, de ce fait, un matériau de base, tout frais en quelque sorte, grâce auquel je voudrais amorcer une réflexion générale portant sur le « mythe » aujourd’hui. Et un matériau différent de celui qui est exploré dans le numéro de Raison présente (1), prétexte à cette réunion. Montrant par là même que cette exploration antérieure demeure inachevée. J’ajouterais volontiers : sans doute inachevable. Car, les « mythes » dont je vais parler, s’ils signalent la puissance qu’a l’esprit de donner à des fables et à l’imaginaire une consistance dont on peut être étonné, ont certes la fonction d’économiser les forces de l’esprit - fonction sur laquelle je vais revenir - mais ils s’accommodent surtout fort bien de variations infinies.
Néanmoins, cette matière proliférante présente simultanément une division, selon les points d’ancrage de son efficacité. Une partie d’entre ces « mythes », en effet, se distribue sur le plan des pratiques du quotidien, afin de les ordonner ; l’autre partie d’entre eux s’étend sans limites sur le plan des pratiques politiques d’Etat. Cela étant, les deux niveaux d’expansion des « mythes » se recouvrent. Bref, ce sont ces deux niveaux qui expliquent le titre de cette intervention.
Titre sur lequel je fais, sur le champ, deux remarques.
La première porte sur la notion de « mythe ». Il faut d’autant moins entendre énoncer, ici, l’objet dont rend compte ce concept sous une valeur méprisante (« mythe » équivaudrait à « amas d’inepties ») qu’il y a une raison des mythes et que raison et mythe sont en rapport dialectique et non en rapport d’inversion symétrique. Le « mythe » n’est pas une erreur de l’esprit, face à laquelle la raison représenterait tout uniment la vérité. Il ne convient pas non plus, mais pour d’autres raisons, de renvoyer ce concept de « mythe » à son sens ethnologique (là où, pour aller vite, il produit des figures de monde et dessine des systèmes structurés de positions) ou anthropologique. Ce n’est pas l’axe qui convient à mon développement. Par contre, pour le dire d’une formule provisoire, j’appelle « mythe » un discours séduisant et cohérent (ni obscur ni délirant ni mensongé), qui contient des ressources satisfaisantes pour le désir et l’action (la non-action en réalité), tout en donnant des repères par rapport aux événements vécus, ou des motifs d’adhésion (catharsis ?) à une attitude.
La seconde remarque porte sur la notion de « méta-récit ». J’appelle « méta-récit » ou « grand-récit », cette fois en un sens explicitement référé, lyotardien 2, les discours qui déploient des fonctions légitimantes en politique, fonctions destinées à construire du collectif sous le mode de l’unité-identité.
Enfin, un dernier mot. Sur le sens de mon propos : il sera politique, il relève, en effet, d’une philosophie politique (et surtout une théorie du contrôle social des pulsions), telle que j’ai pu en développer une dans mon dernier ouvrage 3. Et aujourd’hui, je veux montrer que le terrain du « mythe », au sens précisé ci-dessus, dans les sociétés contemporaines, c’est la pratique (et non la perversion théorique) ; son objet, c’est le contrôle des pulsions ; et son principe, c’est la compensation ; son fonctionnement : les correspondances et les glissades
Qui parle dans le « mythe » : un malaise social et politique !
Ce qui revient à affirmer que la formulation de « mythes » n’est pas condamnable en soi. Et qu’on ne peut envisager de la rectifier que si on change le rapport que les « émetteurs » de « mythes » entretiennent avec l’existence.
Une problématique du « mythe »
En coordonnant ce numéro de Raison présente, j’ai voulu intervenir simultanément dans deux registres. Celui de la situation de notre époque (ses discours, ses croyances, ses modes de réification) et celui de la théorie du mythe (dans ses relations aux pratiques de la raison). Si par sa présence, la raison contribue véritablement à définir une manière d’agir, il fallait examiner les obstacles contemporains dressés contre l’action, ces « mythes » qui transforment en nature ce qui est histoire, et qui donc nous font croire qu’il n’y a rien à faire. De même, si la raison contribue simultanément à définir véritablement un principe d’intelligibilité des phénomènes 4, Décembre 1999, p. 6 sq., il fallait se donner les moyens d’approfondir la notion même de « mythe ».
Autrement dit, la question du « mythe » revient deux fois.
D’abord, pour les « mythes » eux-mêmes : le plaisir de les repérer, de les analyser et d’analyser leurs conséquences (ainsi que l’a tenté Roland Barthes, en son temps). Ce qui est parfois aisé, parfois difficile, parce que les « mythes » n’ont pas de forme définitive, ne sont pas constants, ils se déplacent. Ce sont des constructions proliférantes, et il faut rééxaminer sans cesse leurs trajectoires.
Ensuite, pour la théorie du mythe : autrement dit, pour l’appréciation à porter à l’égard des théories du mythe dans le cadre contemporain, pour le plaisir, là encore, de leur mise à jour, de leur étude et en fin de compte du repérage de leurs faiblesses. Si on laisse notamment la théorie du mythe dans l’état dans lequel le positivisme nous la laisse : une théorie qui coupe la parole aux « mythes » afin de ne pas entendre ce qu’ils énoncent du malaise des hommes. D’ailleurs, comme beaucoup l’ont remarqué les sciences se sont développées, les « mythes » n’ont pas disparu.
Dans la mesure où nous souhaitons évidemment, grâce à nos publications, produire des effets sur et dans la réalité, on peut tirer de ce qui précède une question autour de laquelle déployer des raisonnements-réponses divergents.
La question est celle-ci : S’il existe des « mythes » de nos jours, (différents des stéréotypes qui, eux, imposent des images déjà construites), dans nos sociétés, et si ces « mythes » dépendent de la fonction de nous faire croire que tout va de soi, tout est « évident », alors, il faut se demander à la fois :
- comment les combattre ?
- Et, si nous arriverons à vivre en nous dispensant de « mythes » ? À vivre ou exister sans mythologies ?
À cette question, plusieurs réponses sont possibles :
Une réponse négative :
- On peut toujours refuser le problème et dire qu’on ne peut rien faire. Il y aura toujours des « mythes » ! Bref, convoquer une théorie de la nature des choses pour justifer qu’il n’y a rien à entreprendre. Solution pour moi inacceptable.
Deux réponses positives :
- L’une consiste à répondre : certes, on peut combattre les « mythes ». Dans ce dessein, il suffit d’arriver à substituer la vérité (« la » science) au « mythe ». Solution, à mon sens délicate, car elle consiste à croire que le « mythe » est une erreur de l’esprit, que le « mythe » et « la » science (qui les combat) travaillent au même niveau, sur le même plan et avec les mêmes objectifs ; que le « mythe » dit la même chose que « la » science mais sans l’assistance d’une terminologie adéquate (le « mythe » dirait « mystère », là où « la » science dirait « cause »). Dans cette version, le « mythe » passe, je le répète, pour une simple erreur de l’esprit (comme on disait autrefois une « manière pré-scientifique » d’expliquer le monde), un procédé inférieur de l’esprit connaissant. Ce qui est erroné. Et surtout, j’ai peur que, dans un tel raisonnement, les sciences ne deviennent elles-aussi des mythes, sous le titre de « la » science. Conséquence de cette option : on combat des « mythes » impies avec des « mythes » pieux. Le raisonnement est celui-ci : tous nos malheurs ne viendraient que d’une immense ignorance.... Dès qu’on connait, on abandonne les mythes..., etc.
- L’autre consiste à répondre : certes, on peut les combattre. Mais, dans ce dessein, il faut d’abord reconnaître que « mythe » et « science » ne travaillent pas sur le même plan, malgré les interférences possibles. « mythe » et science n’ont pas le même objet. Par conséquent, le conflit porte moins sur la seule fonction intellectuelle (des apprentissages) que sur le rapport entre les situations concrètes, les situations pratiques et la manière dont chacun conçoit sa situation dans le monde. Le « mythe » n’est pas le symétrique inversé de la science, il s’agit d’autre chose et c’est sur cette autre chose qu’il convient de travailler.
Les usages du terme « mythe »
Je reviens par conséquent, après beaucoup d’autres, sur la question du « mythe », sur le sens de ce concept, ses usages, les variations de ces usages.
Tiré du grec Muthos, mythe réfère à un récit, une fable, une parole qui porte sur ce qui est advenu. Parfois, ce terme renvoie à un récit sacré, puisque muthein signifie parler et raconter. Mais, le mot grec en grec n’a pas nécessairement le même usage que ce que suggère son importation dans la langue française. Or, justement, usages grecs mis à part (chez Platon, par exemple), le mot mythe n’a été introduit dans la langue française qu’en 1804. L’idée de mythe est d’emblée conçue comme un opposé simple d’une raison figée et accompagne la naissance de l’anthropologie « scientifique » (dominée par le « fétichisme » des « primitifs ») ainsi que l’expansion d’un certain positivisme (plus ou moins historisant).
Le mythe est traité comme une superstition infantile, ou une naïveté de la « mentalité primitive ».
Comme vous le savez, c’est avec Claude Lévi-Strauss que nous avons rompu avec cette définition. Nous avons appris combien le récit mythique obéit à une logique rigoureuse et permet de régler les rapports de parenté. Ce geste de Lévi-Strauss a imposé la nécessité de refaire le travail portant sur la réalité du mythe, et de se dégager de la philosophie de l’histoire progressiste dans laquelle le mythe est considéré comme une pensée inférieure et de l’inférieur.
Parallèlement à ce travail de remaniement, le mythe peut désormais passer pour un récit qui met en jeu et à l’épreuve les solutions imaginaires que l’être humain, aux prises avec sa condition, doit sans cesse réinventer pour adhérer à son monde et « continuer à y vivre sans trop d’étripage », comme l’affirmait récemment Dominique Lecourt 5.
Leçon de cette transformation : la refonte de l’étude des mythes montre que l’imaginaire ne saurait se réduire à un regrettable égarement d’esprit en attente de vérité. D’ailleurs, rétrospectivement, de Bacon à Newton, en passant par Kepler (qui était astrologue et « entendait » la musique des sphères) et Giordano Bruno 6, on peut montrer comment les pratiques magiques et divinatoires, liées aux mythes alchimiques et astrologiques ont accompagné et soutenu l’effort de connaissance.
Enfin, on a abouti au retournement du problème ancien : La raison elle-même peut donner lieu à une mythologie. Faut-il croire que cela résulte d’un travail sur la déréliction par lequel la raison tente de combler le retrait de l’absolu divin, grâce à une remythologisation de l’histoire à l’enseigne de la grandeur ? En tout cas, la raison classique peut devenir pour elle-même son propre mythe. Du moins, tant qu’elle ne demeure critique vis-à-vis d’elle-même. Et surtout, quand elle verse dans la production esthétique des figures politiques du peuple (Héroïsme monumental de la raison).
Ce qui revient à découvrir que nos sociétés fonctionnent sans doute aussi à partir de « mythes ». Roland Barthes l’avait, lui-aussi, suggéré.
Champ actuel du « mythe »
Alors, le « mythe » contemporain ? Retenons expressément des exemples précédents que le « mythe », au sens entendu ici, est bien une construction qui a quelque chose à voir avec une situation plus ou moins maîtrisée et des affects (des états psychiques liés à la douleur et au plaisir), disons avec la confiance ou l’hostilité, la convoitise et la restriction, etc. Aussi, avant de justifier l’usage de la notion de « mythe », déployé dans Raison présente, il ne peut être mauvais de regarder du côté des chercheurs et de repérer comment certains d’entre eux font varier le concept de « mythe ». Voici ce que j’ai trouvé :
- Chez Mario Tronti, dans La politique au crépuscule (Paris, L’Eclat, 2000, p. 25), l’idée selon laquelle « Il n’est pas vrai que le moderne n’a pas produit, ne peut pas produire, de mythes », autrement dit l’idée suivante : l’équation historique et structurelle « modernité = raison = fin des mythes » ne correspond à aucune réalité. Il y a sans doute des mythes liés à la raison et la modernité n’a probablement pas été ce que l’on croit. Ce que cela nous suggère : que la notion de mythe peut fonctionner dans un sens particulier.
- Chez des auteurs comme André Akoun (La communication démocratique et son destin, Paris, Puf, 1994), Dominique Wolton (Eloge du grand public, Paris, Flammarion, 1990), et d’autres, l’idée selon laquelle les médias fabriquent des mythes : ici le mythe est caractérisé par sa prégnance (et ces auteurs visent la fabrication de récits qui captent, de personnages qui suscitent des identifications), mais aussi par sa manière de combler des interrogations suscitées par des rumeurs, etc.
- Chez des auteurs plus « politiques » cette fois, la définition de mythes structurant le politique, soit en référence à des régimes spécifiques organisant l’ancrage de la politique dans le magico-religieux et les affects (Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, Le Mythe nazi, La Tour d’Aigues, L’Aube 1991), soit en référence à l’analyse des modes de la construction fictionnelle en politique (Jacques Rancière, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000), autrement dit, une prise en compte des effets et de la prégnance des mythes en politique.
J’ajoute que lorsqu’on consulte tel ouvrage de Dominique Lecourt, notamment sa préface à l’ouvrage de Stephen Jay Gould (Et Dieu dit : Que Darwin soit !, Paris, Seuil, 2000), on trouve aussi cette idée que nous n’en avons pas terminé avec les mythes et même l’idée selon laquelle nous nous sommes sans doute trompés longtemps sur le statut à leur conférer, puisque beaucoup croient encore que le mythe renvoie à une simple crédulité. Or, affirme Lecourt, si tel était le cas, les raisons les auraient depuis longtemps déchus.
C’est justement sur ce point que je voudrais insister. Si ces références ne justifient pas notre démarche, elles l’appuient. Elles revivifient l’usage du terme mythe, en en complexifiant les déterminations ; elles nous obligent à approfondir la connaissance de notre situation. Et, donc, pour la justifier, il est envisageable de dire ceci : l’approfondissement des polémiques autour de la notion de « mythe » enrichit notre regard sur nous-mêmes.
Une théorie du « mythe » contemporain
Après le problème du mot, le problème de l’objet qui est en question : celui de nos comportements et de nos pensées, le problème de que Flaubert appelait la « bêtise » et qu’il identifiait à la « rage de conclure »...
Avant de chercher à savoir si le « mythe » contribue à définir une structure ou une étape de l’esprit, une dimension irréductible de l’être humain, une simple immédiateté de la conscience, une série d’obstacles à la connaissance du monde (naturelle ou social), une modalité de l’opinion, le résultat d’un complot politique, d’une machination, ou encore autre chose, il est bon d’examiner les fonctions que les « mythes » remplissent.
Sur ce plan d’exploration, trois niveaux d’analyse peuvent, me semble-t-il, être développés : celui d’une fonction psychique, celui d’une fonction religieuse, et celui d’une fonction politique du « mythe ».
- Le « mythe » a affaire avec le désir. L’existence est pauvre, sèche, désenchantée, mais l’imagination est riche et merveilleuse. On jouit de se tromper. Si on n’a plus d’illusions, en tout cas, on a encore des désirs. Et on veut habiter un monde vide avec une tête pleine ; même si en se consolant on se perd à la pensée. Le recours aux « mythes » n’est donc pas le fait d’une faiblesse intellectuelle, que l’on pourrait éradiquer par un apprentissage ou la substitution aux « mythes » de la vérité scientifique.
- Le « mythe » a affaire avec la volonté d’attirer l’attention sur soi. Certes, c’est bien le « génie » du « mythe » de calmer des appréhensions, de donner des « explications » qui nous ramènent sans cesse à la tranquillité. Mais, c’est aussi le propre des « mythes » modernes de ne pas travailler sur des espérances inaccessibles : par différence avec les religions (d’Église). Ils travaillent donc sur un plan d’immanence, en rapportant les hommes les uns aux autres. On peut dire, en ce sens, que les « mythes » relient, ont une fonction (autrement) religieuse. En somme, contrairement à ce que croient beaucoup, ce n’est pas qu’ils nous soustraient aux charges de la société. Au contraire. Ils font société, mais entre quelques-uns et qui ne se connaissent pas toujours.
- Le « mythe » a affaire avec « l’esthétisation » de la société et par conséquent avec des dispositifs politiques.
Alors, il n’est peut-être pas nécessaire de se demander si le « mythe » contribue à définir une structure de l’esprit, une simple immédiateté de la conscience, une série d’obstacles à la connaissance du monde (naturelle ou social), une modalité de l’opinion, le résultat d’un complot politique, d’une machination, ou encore autre chose. Pour ma part, je pense que le « mythe », au sens développé dans ce propos, constitue une des solutions imaginaires que l’être humain peut utiliser lorsqu’il est aux prises avec les faiblesses de sa condition sociale et politique.
Esthétisation de la politique et méta-récits aujourd’hui
Le cas se complexifie un peu lorsqu’on tente de pousser le débat jusqu’à interroger les « méta-récits » qui se logent dans le politique. Méta-récits que je fais entrer dans notre cadre, parce qu’on peut les analyser comme des « mythes » politiques dans la mesure où ils s’articulent à des fonctions semblables.
Encore que ! Soyons plus précis : quel rapport entre « mythe » et méta-récits ? Sans doute un rapport d’englobement. En tout cas, le méta-récit se sert des « mythes ». Au sens où on ne va pas des mythes aux méta-récits mais, plutôt, des méta-récits au support que constituent les « mythes ». Les « mythes » figent, le méta-récit les englobe, s’ancre en eux, et porte au niveau de l’histoire la passivité ainsi encouragée.
Précisons ensuite : Qui vise-t-on, en général, sous le terme de méta-récit ? Concrètement : La théorie du progrès, le marxisme, le christianisme, les eschatologies, mais aussi le discours du républicanisme sacralisé ?
Qu’entend-on alors sous ce terme : un discours qui déploie des fonctions légitimantes en politique, fonctions destinées à construire du collectif sous le mode de l’unité-identité ; un discours unificateur capable d’inscrire les innovations dans une perspective téléologique et de pointer des repères pour l’existence commune. En quelque sorte, la construction d’une histoire « monumentale » qui passéifie sans cesse le présent et le futur pour maintenir l’identité politique (au demeurant, morte).
Dès lors, avec cette question des méta-récits, nous sommes placés au cœur des mythes et des rituels dans et par lesquels la politique se fait croyance, cérémonie et ampleur symbolique (au détriment de la prise de leurs responsabilités par les citoyens 7). Et pour analyser, même brièvement, cette question, sous l’angle de ce qui nous concerne directement comme citoyens démocratiques, nous sommes placés au cœur des stratégies politique d’esthétisation du corps politique et de l’Etat.
Au demeurant, la moindre description de la situation politique actuelle nous introduit à un conflit entre un héritage, une situation de perte de crédibilité des méta-récits et une politique esthétisée.
- un héritage ? Celui d’une politique esthétisée, datant de la IIIe République.
- une situation de perte de crédibilité des méta-récits ? Situation qui est réelle, mais qui, au passage, n’est pas toujours la cause des résultats que l’on croit observer : violence, anomie, etc...
- une politique esthétisée qui prend la forme d’une politique esthétique civique.
Les possibilités ouvertes par cette situation sont les suivantes :
- Exprimer une volonté réactive, de retour en arrière. Affirmant : c’était mieux avant (invention d’un âge d’or), on a perdu nos repères, etc. ;
- laisser faire ;
- accepter le déploiement d’une politique esthétique civique : sans doute, pourrait-on y voir une aversion vouée à toutes les grandes « passions » collectives. Avec canalisation des énergies sociales vers des fêtes plutôt que des manifestations.
- Cherche à transformer la situation contemporaine. C’est la version qui aurait mon aval.
On voit, en tout cas, que la question de fonds est bien celle que nous avons traitée : que faire des « mythes » dans la cité ? Sont-ils nécessaires ? Évitables ? Ce qui revient à prendre position sur les rapports entre la question de l’émotionnel en politique et celle de la responsabilité des citoyens.
1 Revue Raison Présente, « Mythologies du XXIe siècle », N° 136, 2001 (14 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris).
2 Jean-François Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1986.
3 Christian Ruby, L’Etat esthétique, Essai sur l’instrumentalisation de la culture et des arts, Bruxelles, Labor, 2000.
4 Christian Ruby, « Raison », in Les Cahiers rationalistes, N° 539
5 Dominique Lecourt, Préface à l’ouvrage de Stephen Jay Gould,Et Dieu dit : Que Darwin soit !, Paris, Seuil, 2000.
6 David Desbons et Christian Ruby, « Giordano Bruno, L’Audace de penser », in Les Cahiers rationalistes, N° 541, Février 2000.
7 Ibidem, L’Etat esthétique, Essai sur l’instrumentalisation de la culture et des arts, Bruxelles, Labor, 2000.
Thème : Conspirationnisme
Mots-clés : Croyance - Mythes et légendes - Philosophie - Secte
Partager cet article
Conspirationnisme
Conspirationnisme et théories du complot sont des concepts aux frontières parfois floues. La sociologue Eva Soteras propose quatre « piliers » qui peuvent permettre de caractériser une théorie du complot : 1. l’absence de hasard ou de coïncidences ; 2. tous les événements sont le fruit d’actions cachées (« à qui profite le crime ? ») ; 3. tout n’est qu’illusion (« on nous ment ») 4. et tous les événements qui font l’histoire sont liés entre eux.
Théories du complot, conspirationnisme : de quoi parle-t-on ?
Le 29 juillet 2021
Complotisme et manipulation : entretien avec les auteurs
Le 11 octobre 2025
L’origine de la pandémie de Covid-19 : science et complotisme
Le 9 juillet 2025
Quand la fiction inspire les théories du complot
Le 8 janvier 2022
La vérité est ailleurs : le complotisme comme fiction
Le 4 janvier 2022